November 12, 1985
How can this be a method? It’s a method — it seems to me very rich — because this method of visibilities can found a whole area of aesthetic analyses. We saw that it’s the same for architecture…architecture is a regime for the distribution of light. There are regimes of light, there are regimes of visibility, exactly as there are regimes of statements. What is a prison ? It is a regime of visibility. What is an asylum, a hospital? It is a regime of visibility. Think about it, it’s frightful…. Power is perpetually that by means of which we are seen and we are spoken about.
Seminar Introduction
After Michel Foucault’s death from AIDS on June 25, 1984, Deleuze decided to devote an entire year of his seminar to a study of Foucault’s writings. Deleuze analyses in detail what he took to be the three “axes” of Foucault’s thought: knowledge, power, and subjectivation. Parts of the seminar contributed to the publication of Deleuze’s book Foucault (Paris: Minuit, 1986), which subsequently appeared in an English translation by Seán Hand (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988).
For archival purposes, the English translations are based on the original transcripts from Paris 8, all of which have been revised with reference to the BNF recordings available thanks to Hidenobu Suzuki, and with the generous assistance of Marc Haas.
English Translation
Having previously considered the flip side of the question “what is a statement?” by examining visibilities, Deleuze insists on the importance of determining the corpus of knowledge, the criteria resting in power which is thus immanent to knowledge. So Foucault seeks the sites of power and of resistance to power in the 19th century, with experience always conditioned and gridded by power relations. Such relations are discussed, says Deleuze, in Foucault’s essay “The Lives of Infamous Men” (La vie des hommes infâmes), after which, in Foucault’s last books, he seeks to “cross the line”. Remaining within this reflection on knowledge-power through the constitution of one’s corpus, Deleuze also reflects on how Foucault examined visibilities, how for Foucault, the “one sees” is light while the “one speaks” is language. Exploring how these distinctions emerge in The Birth of the Clinic, Deleuze then pursues them with examples from different regimes of visibility, notably figures of light for the painters Robert Delaunay and Paul Cézanne. Deleuze then delineates four levels of difference between statements and the group of words, sentences and propositions: first, the inherent mixture of systems in speech; second, the necessary choice to be made within this multiplicity, with Foucault’s own position regarding the subject being that statements have no author, but an “author function”, also emphasizing the example of free indirect discourse as a means of short-circuiting subject positions. Deleuze indicates that the statement refers to variable subject positions, all ordered according to a “one speaks”. As the session ends, Deleuze indicates a third level, within the proposition, referring to a state of affairs to which he will return in the next session.
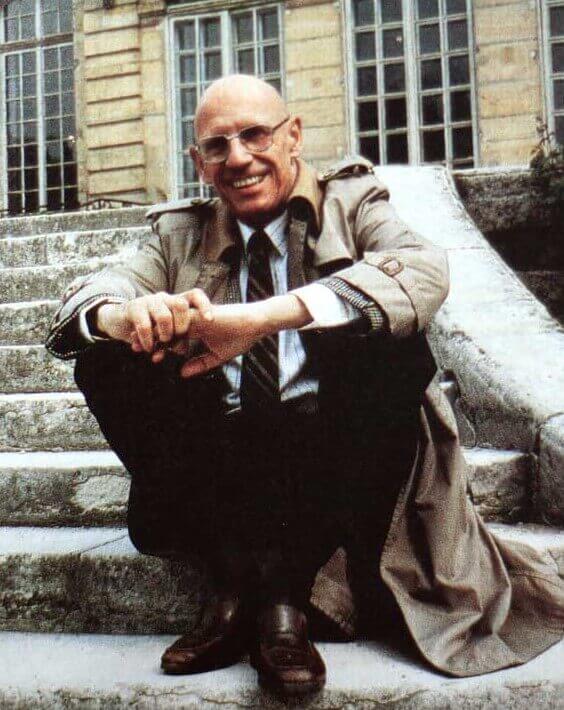
Download
Gilles Deleuze
Seminar on Foucault, 1985-1986
Part I: Knowledge (Historical Formations)
Lecture 04, 12 November 1985
Transcribed by Annabelle Dufourcq; time stamp and supplementary revisions, Charles J. Stivale
Translated by Mary Beth Mader; additional revisions, Charles J. Stivale
Part 1
. . . to think [or: has thought] of Foucault. This point amounts to asking: but what is it, exactly, that he calls a statement? So then, my task, at the close of this effort, my task is to try to give an answer, an answer—and, here, you must press me if this answer is not clear and concrete. Because the question is indeed: what is a statement, insofar as a statement is not to be confused with words, sentences, or propositions.
So, on this point, you’ve got to be very severe. If I don’t give an answer, well, you’ll have to say: that won’t work, all that! In exchange for which . . . I’ll permit myself to go very slowly, that is, to take the detours that seem necessary to me, because, once again, it’s a question that seems complicated to me. And Archaeology of Knowledge is assuredly a difficult book. So, I permit myself certain detours, notably in order to answer a question that one of you asks me. And this question, I’ll read it so that you can retain it, and I think one can in fact ask it.
This is the question: “One can think [about] things without there being any visibility; there is no co-implication between the two,” says the person who asks the question. “On the other hand, one cannot think [about] words unless statements exist.” All that seems uncertain to me, okay, I’m trying to . . . – “even if their primary source is a ‘one,’ one cannot say that words are not statements, and thus the cause of statements would be statements themselves.” You see: I’m focusing minimally on this part of the question: one can speak of things independently of visibility, one cannot speak of words independently of statements. In my view, no, it wouldn’t work, if this were the view. But it’s complicated to try to get clear amid all of this. So, our fundamental question—still under the heading of “but what does ‘knowledge’ mean?”—is this sub-question: “but what does ‘statement’ mean?” And all we know to orient ourselves is that the statement, once again, is neither a word, nor a sentence, nor a proposition. Okay, so, where were we on this?
Here’s where, last time, I sensed the need to start with a detour, supposing that perhaps the other half, the other side of the question, namely, the question of visibility, could shed some light for us on the main question concerning the statement. And last time, we were about at this point. I was saying: you see, we’ve reached the point where, as for the story of the statement, Foucault’s method consists in saying: when you set out a problem, whatever problem it is, give yourself a corpus. You start from a corpus. A well-defined corpus, depending on the problem that you set for yourself, depending on the research you are conducting. You see, at this level, he does not grant himself the statement—that would be very, very vexing, there would be a vicious circle. He does not grant himself the statement, it’s a corpus of words, sentences, and propositions. Only they are no longer simply words, sentences, and propositions, since they are words, sentences, and propositions grasped insofar as they form a corpus. So, that’s already a first step in his method. The subjacent question arises from this—we saw it last time—“but how does one constitute the corpus?” How does once constitute the corpus? Try to understand how this question is, already, a very complicated one. For if I must start by constituting a corpus in order to manage to understand what [a] knowledge [un savoir] is, then the means I use to constitute the corpus must not presuppose anything from [a] knowledge [un savoir]. Otherwise, the method wouldn’t work.
In fact, from the start my problem has been: “what is knowledge?” And I say, for example, “to know is to state.” Okay, how are statements to be found? I start off from a corpus of words, sentences, and propositions. Here, an objection: “How do you constitute the corpus?” If in constituting a corpus, I appeal to anything that presupposes [a] knowledge, that won’t work. [Pause] As a result, in Foucault’s early books, you will not find any rules by which he constitutes his corpuses. You won’t find them. Furthermore, he goes so far as to say: Oh, me, I only make fictions, my corpuses are fictions. Which amounts to saying: I am a sort of novelist.
So, he’s not wrong. At the same time, we know very well that it is not true and that, right from his early books, he already had an idea that he would not develop until later. But what is this idea? If I then take the subsequent books, the answer explodes, and for us it is at least provisionally satisfactory, even if we will study it directly later this year. But if I already refer to this answer, these criteria for the constitution of the corpus, once we specify that these criteria must not be drawn from [a] knowledge, from what then will they be drawn? They will be drawn from power. That is, once a problem is given, I constitute the corresponding corpus by determining the sites of power put into play by the problem. Whence Foucault’s idea, which he had from the start, but which he will not explicate until much later, namely: power is strictly immanent to knowledge.
What’s the concrete result of this? We’ve already seen. He wants to constitute, for example, a corpus of sexuality, that is, a corpus of words, sentences, and propositions of sexuality in the period under consideration. How does he constitute the corpus? The answer is very simple: let us determine the sites of power put into play by sexuality at a given point in time, for instance, in the 19th century. What are sites of power “and of resistance to power,” put into play by sexuality at a given point in time? Well, he’ll tell us: ecclesiastical power, not in general, but particularly in the confession; the power of the schools, not in general, but particularly in boarding school rules; juridical power, on the level of expert witnesses, not in general, but with respect to psychiatric expert witnesses about perversions, etc. I can, in any case, set out a finite number of sites of power around which sites, around each of which sites, are formed circles of words, sentences, proposition. That’s how I constitute a corpus. Good.
But you see that this opens up for us, although we have just barely broached the question “what is knowledge?”, this opens future questions up for us. What are these questions, above all? I can already indicate them, and then set them aside right away, since to move on to them I would already have had to settle the question: “what is knowledge?” They are: what actually are these centers of power? And, especially, why does Foucault break with phenomenology, from the start, by telling us all the time that “there is no wild experience, there is no free experience?” It’s because experience is always conditioned and gridded by power relations. And, finally, wild experience would be the experience we have, of centers of power when they question us, that is, the opposite of a wild experience, of a free experience. And also: whence Foucault’s doubt, Foucault’s melancholy, when he says: well, yes, people will say—he loved raising objections to himself, it’s always better to raise one’s own objections, since those from others, it’s . . .—so, he used to say: but people will say to me—in other words, “I’m objecting to myself”—“your thing’s no good, you’re not making it across the line,” he said. “You’re still staying on the side of power.”
But, my God, but my God, how he did not stay on the side of power! But, in his thought, did he stay on the side of power? In the sense that power relations, sites of power, are there to determine the corpuses. And in a very beautiful text, drawn here, as always, from this article, “The Lives of Infamous Men,” [“La vie des hommes infâmes”],[1] about which I spoke to you a bit last time, he says: “People will say to me” [Deleuze laughs], “people will say to me: ‘Here you are again, always with the same inability to cross the line, to cross over to the other side, to hear and to make heard the language that comes from elsewhere or from below; you always make the same choice, from the side of power, of what it says or what it causes to be said.’” And I believe that one of the reasons for Foucault’s long silence, there are many reasons, between History of Sexuality, Volume I and The Use of Pleasure, at least one reason, is this problem that became more and more pressing for him, namely: How to cross over to the other side? How to cross the line? Isn’t there something still beyond lines of power, and how does one reach them?
But, for the time being—we’ll see how this problem is set out and resolved by Foucault—but for the time being, we, we can be fully satisfied with this first answer. We are not yet asking the question of power, since we are in the midst of the question of knowledge, and we’re merely saying: oh, well, right, his corpus of words, sentences, and propositions, in fact he sticks to the conditions of his wager, he can form it without presupposing in any way what is in question, that is, “what is knowledge?” Because he forms the corpus of words, sentences, and propositions depending on the sites of power and resistance in operation, implicated by the corresponding problem. You set out a problem, for example: what is going on with sexuality in the 19th century? You form your corpus, without a vicious circle, to the extent that you ask: what are the words, sentences, and propositions that orbit around the sites of power implicated by sexuality or that concern themselves with sexuality? This is clear, right? It’s very important for what is to come, for us, since it shows a certain relation, a certain presupposing of power by knowledge.
So, once you have your corpus, what do you do? [corpus] that is highly varied, and you see that it gains its unity on this basis: it is the corpus of sexuality. What happens? [Deleuze considers the drawing on the board] Well, from this corpus, what do you induce? We saw this the last few times, something one can call by various names: a ‘there is,’ the ‘there is of language,’ or else—it amounts to the same thing—a ‘one speaks,’ or else—it amounts to the same thing—a language-being, a being of language. But what is this? This is an empty generality—‘one speaks,’ ‘there is language,’ a language-being. In what way is this linked to the corpus? How does one derive it from the corpus? It’s not complicated, you’ll recall, this is the result of the last sessions. It’s not a matter of a universal, it’s that language-being, the ‘one speaks,’ is inseparable from a given historical mode that it takes on in relation to a given formation. It is inseparable from its historical modality.
In other words, it is this ‘one speaks,’ this ‘there is language,’ this language-being, it is a way in which language gathers in a given formation. And in fact . . . So, “in a given formation,” that is, the way in which the language gathers . . . can I say in the 19th century? Yes, at a pinch, I can say: language gathers in a certain way in the 19th century. But it’s a large, a very large gathering: language-being in the 19th century or the ‘one speaks’ in the 19th century. It’s really a very vast gathering. Understand that in fact there is a gathering of language for each corpus. Each corpus effects a certain gathering of the whole language. And, in fact, the corpus of sexuality effects a certain gathering of the whole language around sexuality. And so much so that each corpus effects a gathering and each corpus refers to a language-being, to a ‘there is language.’ Only, I can speak of a ‘there is language’ proper to a whole historical formation to the extent that the historical formation is defined in relation to these corpuses, in relation to the whole of these corpuses. So, at that point, there will be a great gathering of [the] language that will correspond to the language of the period or of the formation. Okay. Are you still alright? Interrupt me if something isn’t right, because it’s got to . . . [Deleuze does not finish the sentence]
So, I would say . . . statements . . . here [pause; he writes and draws on the blackboard], it’s as if statements are at the intersection—that’s this dotted line—they are as if at the intersection of the corpus of words, sentences, and propositions, and the language-gathering on the corpus. Or else, in the book on Raymond Roussel, Foucault will tell us: to find statements, you have to break open or open up, one must break open, open up, words, sentences, and propositions. And what opens up words, sentences, and propositions? The ‘there is language.’ The ‘there is language,’ the gathering of language on the corpus that forces the corpus to open up and to release statements, which it would otherwise keep enclosed within. Okay.
But all this is metaphors, right? “Break open, open up,” okay, so, if I’m at my dotted line, like so, I’ve got the diagram for the statement, but I have to fill in the interval. [Deleuze indicates the blackboard drawing] Between the gathering of language and the corpus on which it gathers, that’s where the statement emerges. This still does not tell us what a statement is, but it will compel us to spell it out. There you have it. Time for break: I need to make a detour . . . [Interruption of the recording] [20:55]
Part 2
. . . pole of knowledge as essential as statements, I have no choice, I must find a result or configuration that is analogous in the case of the visible. Yet, it is certain that Foucault conducts the analysis directly for the statement and does this much less so for visibility. But this wouldn’t be the first time that the paths are so complicated that, right at the point where he seems not to move on to absolutely necessary analyses, it’s in fact there that a little clarity shows up for us. Since . . . what’s going on for visibilities? I would say: well, you know, it’s the same thing. It’s the same thing. You’d like to know what is visible at a certain period. We saw this theme. At a given period, there are things that can be seen and, when they can be seen, they are seen; there are others that cannot.
If, once again, the 17th century put the mad, vagabonds, and the unemployed in the same place, it’s not because it saw no difference, it’s because it sees a resemblance that will stop being perceptible in other periods. What resemblance? That’s what visibility will be. [Pause] If you’d like to know what a visibility is, you have to start from a corpus as well. It won’t be the same corpus. In this case, it will no longer be a corpus of words, sentences, and propositions—what’ll it be? It will be a corpus of objects, of things, of states of things, and of sensible qualities. You’ll perhaps understand immediately that what is at issue is that, in just the same way that statements . . . in the same way as for statements, we knew it, we did not know what they were. But we knew one thing: if statements have a sense, they refuse to be reduced to words, sentences, or propositions; they’re not the same thing. We do not know what visibilities are, but we know that if they exist, they refuse to be reduced to things, objects, states of things, or sensible qualities.
As a result, I start from a corpus of objects, things, etc. and in so doing, I presuppose nothing about what is to be found, namely: “what is a visibility?” I start off from a corpus, a corpus of things, states of things, sensible qualities at a given period. It could be an architectural corpus, among others. There will always be some architectures in my corpus. Or if I’m interested in painting, I start from a corpus constituted by this or that painting. I’m not going to discuss—just as it is false that the linguist discusses language in general, the linguist always starts from a determinate corpus—well, an art critic doesn’t discuss painting in the 17th century in general. The critic always starts from a determinate corpus, that is, a determinate set of paintings, and surely, the results would not be the same had another corpus been selected.
In any case, we have the same problem we had earlier: yes, but how do I constitute this corpus? In my view, Foucault’s answer—an implicit answer, but precisely, it can be . . .—the implicit answer will be the same as for the corpus of sentences, namely: I rely on sites of power and resistance at work in the problem I’m examining. What does this mean with respect to painting in the 17th century? It has to mean something if I am correct in this reading of Foucault, it has to mean something. And so, yes, for example, I see that in the 17th century—here I’m saying hugely banal and commonplace things—I see that in the 17th century at least an entire corpus of paintings can be defined as “portraiture.” Portraiture. I can think: okay, the second half of the 19th century sees a return to portraiture, notably with [Vincent] Van Gogh and [Paul] Gauguin. You don’t need to know much about painting to know that portraiture for Van Gogh and Gauguin is not part of the same corpus as portraiture for the 17th century painters, and thus that portraiture in general, portrait painting, does not form one corpus; it’s astride numerous corpuses.
What is at issue in the corpus of “17th century portraiture?” Among other things—I’m not saying “solely”—power relations, immediately. Which power relations? Power relations between painters and their models. What is the model in the 17th century? It is above all the lord, or better still, the king. What is [Diego] Velásquez’s Las Meninas, in the famous commentary that Foucault will derive from it? What’s happening there? What’s happening is that there’s a painting that shows us a facing view, as it were, of the royal family, and the painter who is looking at something, or someone, which we can’t see. We only see the painter’s gaze, and everything that everyone in the painting is looking at, as a reflection in the mirror at the back of the painting. And what everyone was looking at was the royal person, who, we can see this in the mirror, is looking at those who are looking at him. In other words, an exchange of looks, yes, but on the basis of a relation of powers: the power of the painter and the power of the king. Very well. So, it seems to me that at this level Foucault’s own analyses confirm that the corpus I will constitute is indeed determined on the basis of the sites of power at work in the problem that is posited. For example, “what is a portrait in the 17th century?” Okay. So, I have my corpus that I can call architectural, pictorial, whatever you want. Good.
Thus, until now, the parallelism between my two series, the statement and visibility, is verified. What do I do, once I have my corpus? Once I have my corpus . . . It’s possible that my corpus is just a single painting. It could be ten paintings. It could be the conjunction architecture-painting. You see, it could at the extreme be the corpus for the century, or the corpus of the historical formation. And so, once I have my corpus, I set up . . . I do the same thing, I set up my vertical line and I ask the question: what gathers in the corpus, on the corpus? It was not hard, earlier: what gathered on the corpus of words, sentences, and propositions was language-being in or as such-and-such a mode. Now, here, what gathers on the corpus, on the physical corpus of things, states of things, qualities, etc.? Well, it seems to me that Foucault’s answer was—I would say as much—“there is light.” Or else—but this won’t be easy to understand, or on the contrary, perhaps it will be, I don’t know—or else “one sees.” Or else “light-being,” the gathering of the whole of light on the corpus. Okay. What does that mean? It means that ultimately a painting is a figure of light. What is primary is light. No, at this point it’s not a matter of knowing whether it’s true, not true, etc. It’s a matter of knowing to what extent this idea is important and interesting. A bad idea is an idea of no interest. A good idea is an important and interesting idea.
So, okay. I understand what this means: but, of course, a table gathers, in a particular mode, in its mode, all the light of the world—it does not divide light, light is indivisible . . .—it gathers, in such-and-such a mode, all the light of the world. Exactly like a corpus of words, sentences, and propositions gathers in its own particular mode, all the language of the world.
What is primary is light. What does that mean? That means: do not think that light is a physical medium [un milieu physique]. Light is not a physical medium . . . that is, light is not Newtonian. Light is no more a physical medium than—it is also a physical medium, but, for example, light as a physical medium is called “secondary light”—light is something more than this. What is it? Well, it is indeed what Goethe and not Newton intended, namely: it is an indivisible, it is a condition, it’s a condition for experience and of the medium. It is an indivisible condition. It is what philosophers call an a priori. Mediums develop or are extended in light. Light is not a medium. Light is an a priori condition, that is—this originates with Goethe, against Newton—what can be divided is a secondary light. Primary light is an indivisible. It falls on the corpus of things, states of things, and qualities; exactly as the whole of language, language-being, fell on the corpus of words, sentences, and propositions. Light is not divisible: it falls. And, in falling, it captures that on which it falls. What is primary in painting is light; it is primary in relation to lines, primary in relation to colors. Colors and lines derive from light and not the reverse. A painting is first a tracing of light [un tracé de lumière].
You’ll ask me: but why does he say that? Why does he say that? Well, that’s what he says. So. It’s up to you to find out whether it suits you or not. If it does not suit you, then no matter. No matter. Try and grasp that it’s ridiculous to think: but, really, is it true or not? That makes no sense, because he is proposing an analysis in which he extracts a condition in relation to something that is conditioned. For his part, he has the sense, let’s suppose before a painting, for example, he has the sense that light plays the role of condition in relation to lines and colors. Can one make a theory as interesting as this one where color would be the light? It’s a stupid question: you’d have to actually create it. You’d have to create it, and then we’ll see. What? Is it a question of taste? No, it’s not a question of taste. It’s not by chance that some of us will feel compelled to say: no, it’s not light that’s primary.
So, then, everything is of the same value? No, not at all, everything is not the same value. You’d have to actually create it. So then: at the point where we now are, we in particular, what interests us? We can see well, and in what sense, that for Foucault a painting is above all a tracing of light. It’s not solid lines; in painting, the line [le trait] is a solid line. [Pause] Beyond solid lines, or rather, as a condition for all solid lines, there are lines of light. And lines of light are not solid lines painted in yellow. Indeed, for example, in Velásquez’s painting, Foucault gives us a description on page 11 [in The Order of Things],[2] a description, at one point, in terms of light: “the groove in the wall from which the light is pouring….” So, for the figure of light, here’s what he tells us: “This spiral shell presents us with the entire circle of representation: the gaze” — the gaze of the painter upon the canvas – “the gaze, the palette, and the brush, the canvas” — of which we see only the back — “the paintings, the reflections”, — etc. etc. . . . We can see only the frames, and the light that is flooding the pictures from the outside, but that they, in return, must reconstitute in their own kind, as though it were coming from elsewhere, passing through their dark wooden frames. And we do, in fact, see this light on the painting, apparently welling out from the crack of the frame; and from there it moves over to touch the brow, the cheekbones, the eyes, the gaze of the painter, who is holding the palette in one hand and in the other a fine brush . . . And so, the spiral is closed, or rather, by means of that light, is opened.”
We can see clearly the lines of light, these are not the solid lines drawn by the painter. They’re truly the condition that lays out the painting as a field—as a field of what? As a field of visibility. In other words, just as the ‘there is’ of language was an a priori, but an historical a priori, since it was the condition in relation to a particular corpus or to a particular historical formation, so the ‘there is’ of light is an historical a priori. Light in the 17th century, that is, the way in which light gathers, either in 17th century painting, or in 17th century portraits, or even in a single case, the way in which all the light in the world gathers in Velázquez’s Las Meninas. Such that visibilities will be exactly what I just said for statements. This will be the dotted line that opens up. To find the visibilities one must break things open, one must open qualities up. Visibilities are neither things, nor qualities. Well, then, what are they? They are what emerges when the corpus of things and qualities meets light-being. Visibilities are lines of light.
Okay. But, put differently, visibilities are not first defined as acts of a seeing subject, nor as the givens of a visual organ.[3] Especially not! They are neither qualities, nor states of things, nor visions. The ‘one sees’ is not a vision, the ‘one sees’ is light. The ‘one’ is light, just as the ‘one’ in ‘one speaks’ is language.
But then why call these visibilities? Because of “light.” Because they are given by light, by light as indivisible. And in as much as they are given by light, then, yes, they are related to sight, but they are related to sight only because they are given by light. Even more: it’s through light that they are related to sight. In other words, you see, they are related to sight only secondarily. Visibilities are related to sight only secondarily, they are in fact related to sight by light. But from here, there’s no more stopping. It’s a chain reaction [un emballement], since if visibilities are related to sight only secondarily, they do not relate to sight, or rather they are not related to sight without also being related to the other senses. To the ear, to touch, etc. Such that visibilities, far from being givens of the visual organ—what are they? They are complexes that are multi-sensorial, optical, auditory, tactile . . . But why call them “visibilities?” In fact, they are complexes of actions and reactions, multi-sensorial complexes of actions and reactions, of actions and passions. Why call these “visibilities?” They are visibilities insofar as these complexes exist only to the extent that they come [in]to [the] light. They do not exist as long as the light does not draw them to itself, as long as the light does not make them come. [Pause]
Oh, really? But does Foucault actually say that? That’s all very well, but does he say that? You understand? Visibilities are called visibilities because they find their condition in light, as indivisible, as an indivisible element—not at all Newton, but Goethe. Thus, visibilities are related to sight only secondarily and, to the extent that light relates them to sight, light does not relate them to sight without also relating them to the other senses. Does he say this? Yes, he says it. Yes, yes, yes. He says it, and in a very odd passage in Birth of the Clinic, where, there, the example he gives is no longer aesthetic or artistic, but epistemological. It concerns what happens in pathological anatomy and he tells us that, I’ll read the passage . . . It’s about the new methods introduced by [René] Laennec. And you know that Laennec is famous for, among other things, having introduced tactile and auditory data [des données] into medicine, into diagnostics. A percussion of illnesses and an auscultation of illnesses. And here’s how Foucault reads this: “When Corvisart” – he’s another physician of the period — “hears a heart that functions badly” –so, that’s auditory – “when Laënnec a high-pitched voice that trembles, what they see . . . is a hypertrophy, a discharge.”[4] “When Corvisart hears a heart that functions badly or Laënnec a high-pitched voice that trembles, what they see with that gaze that secretly haunts their hearing and, beyond it, animates it, is a hypertrophy, a discharge.”
“[T]hat gaze that secretly haunts their hearing …” That is: this gaze, this ‘one sees,’ is in fact not a gaze. It’s a light-being that draws to the light not only what is seen, but likewise what is heard and touched. This question of “coming [in]to [the] light” is not a question of space. When Corvisart hears a heart that functions poorly, there is something that comes to light. What? Hypertrophy. “[W]ith that gaze that secretly haunts their hearing and, beyond it, animates it,” and Foucault continues: “Thus, from the discovery of pathological anatomy, the medical gaze is duplicated: there is a local, circumscribed gaze”—that’s the ‘I see.’ There is a gaze that is I see, with my eye. “[T]here is a local, circumscribed gaze, the borderline gaze of touch and hearing.” The gaze of the ‘I see’ in fact is what my eye sees, which borders on what I sense, what I hear; it’s a “borderline gaze of touch and hearing, which covers only one of the sensorial fields.” Which covers only one of the sensorial fields, one among others: there is the optical field, but there is the auditory field, there is the tactile field, etc. One among others.
Foucault says as much: that’s only the first gaze, or rather, we should say, it’s only the secondary gaze, since this secondary gaze is conditioned—but in the same way as the other sensorial fields are—by a primary gaze. The primary gaze does not condition the secondary gaze without also conditioning the other sensorial fields, that is: it conditions the secondary gaze in its relations with the other fields. And in fact, Foucault tells us: “But there is an absolute gaze . . .” In fact, it’s not a gaze, it’s light-being . . . “[T]here is [also] an absolute, absolutely integrating gaze that dominates and founds all perceptual experiences. It is this gaze that structures into a sovereign unity that which belongs to a lower level of the eye, the ear, and the sense of touch.” The term ‘absolute gaze’ is plainly not a felicitous one . . . on the contrary, it is in fact very felicitous: one must replace it with light-being. It’s the same thing. The absolute gaze is light.
For those who were here in the other years, you’ll perhaps recall that in [Henri] Bergson there is a very similar theme: light is in things, the gaze is in things. “[T]here is [also] an absolute . . . gaze”—that is, a light-being —“that dominates and founds all perceptual experiences.” It’s also very close to Heidegger, you know, it’s the Lichtung. And in [Martin] Heidegger’s case the lineage with Goethe is immediate. But I believe no less in a lineage, in a lineage in the case of Foucault, a direct lineage to Goethe on the theme of light as an indivisible condition.
And he continues: “When the doctor observes, with all his senses being open, another eye . . .” When the physician observes with his eyes, but also when he percusses with his fingers, when he listens with his ears . . . “When the doctor observes, with all his senses open, another eye is directed upon the fundamental visibility of things . . .” What does “the fundamental visibility of things” mean? It means when things are no longer there as things, when things are broken open and they release pure visibilities. And what are pure visibilities? It’s the relation of things, states of things, and qualities with primary light as indivisible condition. At that point, visibilities emerge. When primary light falls on things, then things break open, they are shucked, they open up. They open up so that what can emerge? Pure visibility that rises [in]to the light. And this pure visibility, surely, will be related to the eye, but it will not be related to the eye without also being related to the other senses. So, all this is very good. This is all very good!
Whatever does this mean? This time, consider another thinker who happens also to be a painter himself. I talked about him in other years: [Robert] Delaunay. How is Delaunay also close to Goethe? It’s very simple. Delaunay, it’s not what he says. What does he make us see? He has an idea, a painter’s idea. His painter’s idea is very simple. It’s hard to do in painting, but it’s simple to say, namely: figures are not first solid, what is primary are figures of light. That is, visibility is the figure related to light. At that point, it’s no longer a solid figure. Light, too, is an indivisible condition, and what is this indivisible condition? The production of luminous figures. Light produces figures that belong to it.
You see: light is no longer composed, as it is for Newton. That’s the big distinction between the Newtonians and the Goetheans. Light is an indivisible condition and hence is productive; it produces figures that belong only to it. In other words, light is movement, light is production. Consequently, one must not confuse the things that move and the movements of light. Nor must one confuse the lines of things and the lines of light. Neither must one confuse the figure of the thing when light meets it with the very figures of light that light forms at the surface of things. And what is the painter’s task, for Delaunay? To break things open, to open states of things to reveal the pure figures of light. And what will this revelation be? It will be the figures for which Delaunay is famous: the circles, the half-circles, the helixes—with the great division: there are lunar figures and solar figures. The Moon is no less a light than the Sun, so that, ultimately, it’s a split condition. Light is an invisible condition: yes, but it has at least two sides: solar and lunar. Okay, and Delaunay’s luminous helixes, the circles, Delaunay’s luminous semi-circles, will affirm their primacy over both solid lines and colors. Colors are born of light, lines are born of light. What is primary is visibility, that is, the figure of light.
And Delaunay had an admirable remark, that explains his whole project, it was a witticism, sometimes it’s the witticisms … He was settling a score with Cubism, with the Cubists, and he said: you see, what is [Paul] Cézanne’s contribution to painting? He was terrific, Delaunay, he saw very clearly, he said, Cézanne’s fundamental contribution to painting is to have broken the fruit bowl. It’s nice, because to break the fruit bowl is to break things open.
Cézanne, in the 19th century, broke things open. Undoubtedly, the Impressionists had prepared the way, but, no, they had not broken things open in their materiality. They created a play of reflections, it was a very particular regime of light: they made reflections play across things. But as for Cézanne, he broke the fruit bowl. That is, he breaks open, he shatters the thing in its materiality. And he says: there’s no point in trying to glue it back together. Cubists are like guys — that works out fine for them, but in a certain way it’s right — he says: they’re guys who are constantly trying to glue the fruit bowl back together, but who go wrong. They put a piece that doesn’t go with another piece that doesn’t go, and they think they’ve glued it back together. And they actually have glued it back together. But you shouldn’t glue back together what Cézanne had broken. On the contrary, what should have been done was to take the direction Cézanne took, that is, to the new figures make emerge that Cézanne had made possible, that is, pure visibilities. There you have it.
So, I’m saying, okay, understand that I’m not trying to push Foucault toward points that he did not develop. That’s why, I would say, to answer your question: no, visibilities are not at all . . . there is no . . . it’s exactly like statements. Just as statements imply language, all things, in fact, imply visibilities: all you need to do is break them; in fact, they must be broken. The corpus is there only so that visibilities emerge, and visibilities are not givens [des données] of sight. They are related to sight, even more—I forgot—in the text I was reading to you, on 167,[5] he uses a very strange word: “In any case, the absolute limit and the ground of [all] perceptual exploration are always limned by the clear plane of an at least virtual visibility.” Do you see why “virtual visibility?” Because visibility is related really, actually, to sight only by the intermediary of light—which does not relate it to sight without relating it to the other senses.
Okay, so you see. What do you see? You see . . . I’ll tell you: how can this be a method? It’s a method, it seems to me very rich, because this method of visibilities can found a whole area of aesthetic analyses. Because we saw that it’s the same for architectures. To understand an architecture, one has to break open, one must see. It must be understood as: architecture is a regime for the distribution of light. There are regimes of light, there are regimes of visibility, exactly as there are regimes of statements. Before seeing in it . . . again, as I told you, a prison is what? It’s a regime of visibility. An asylum, a hospital, is what? It’s a regime of visibility. Think about it, it’s even frightful, and this is how, this is how it’s so tied to power, and why Foucault was so very, very aware that . . . power is perpetually that by means of which we are seen and spoken about. Power speaks us and power sights us.
When do you know you’re in the hospital? You know you’re in the hospital when, instead of the full door of your bedroom, you see that disturbing door through which you are seen. You know, with the three little bars, there, the three little bars where . . . and then you’re pretty sure that the door doesn’t close, that is, that the head monitor, as one says in both hospitals and schools, that the head monitor can come in at any moment. Awful! Awful! I won’t even discuss prisons: we saw that they are made for that, that is, their whole stone architecture is made so they operate, so that the prisoners can be seen without themselves seeing, and that those who see them cannot be seen.
You may say: if you propose this kind of an equation, I would say: this is an equation of visibility. How to solve the equation? With stones, that is, with things and states of things. But what you will have incarnated with stones, that’s your equation, that is, pure visibility. I’m saying: the prisoners must be seen without seeing, the guards must see without being seen. And, yes, this is what I would call a virtual visibility, a distribution of seeing and being seen. What actualizes it, what realizes this virtual visibility? There’s a perfectly simply answer: it’s stones, it’s a disposition of stones. A disposition of raw materials . . . A disposition of raw materials, which are materials you can touch, feel, hear, listen to, listen to the sound they make, etc. What is all this? It’s simply the actualization of the figure of light. You see, Foucault goes much farther than saying: there is one sense that has primacy. He does not at all say: sight has primacy over all the other senses. He tells us something much more profound. He says: light, as condition for sight, does not relate the visible to sight without also relating the visible to the other senses. It’s a primacy of light, it’s not a primacy of one sense over another. This is the way in which it’s completely Goethean.
Okay, so, I’m saying: you can derive a method of aesthetic analysis from this. You can derive a method of scientific analysis from this, using scientific statements. But what complicates things is that—but we can only see this later, since we’ve seen that it will be a problem for us, so we must definitely return to this problem—these two, here, they are extremely . . . they do not have the same form, no matter how complete the parallel between them, there is an absolute difference in nature between visibilities and statements. We can come back to this problem only later. But, in any event, that doesn’t rule out—I really want to say this, even at this point, since we can work all this out clearly later on but let me nonetheless remind you—that despite the fact that there is an absolute difference in nature between the two, this does not rule out that each one constantly captures the other. That is: regimes of visibility capture statements, statement regimes capture visibilities… [Interruption of the recording] [1:06:11]
Part 3
… Literature is composed not only of statements, it is also composed of visibilities captured by statements. How may this difference between statements and captured visibilities be indicated in language? I believe strongly that, in language, statements and descriptions are different in nature. Descriptions are not statements, they are visibilities. On my side, I have some very eminent logicians, [Bertrand] Russell, for example, who in his book that founded modern logic, Principles of Mathematics [1906], already indicated the difference in nature between propositions and descriptions. And, in a certain way, modern literature also worked out to a great extent the difference in nature between . . . in an entirely other way than Russell did . . . For example, I think the nouveau roman is wholly based on a certain dualism between statements and descriptions.
With Foucault, too, in his work, there are statements, philosophical statements—but why is his body of work interspersed from one end to the other with descriptions, be it descriptions of paintings, or descriptions of things that Foucault treats as if they were paintings? For example, when he describes the prison, he describes it as if it were a painting. There is a proper function of description in Foucault’s work that cannot be reduced to the statement. Moreover, there is an author, among the great geniuses of our literature, of modern literature, there is an author who it seems to me has established the value of this, the greatest luminist, if you will. Just as there are luminists in painting, great luminists in painting—Delaunay, for instance: he’s not a colorist, he’s not a draughtsman, he’s a luminist—okay, so, there are great luminists in literature.
I believe the greatest luminist in modern literature is [William] Faulkner. If I just try to show the Faulkner example in the framework we’ve just derived, what would we get? Can it . . . A method should have many applications, should be very fertile. What’s going on in Faulkner? First, there is something frightening, frightening: namely, it calls on all the senses, all the senses, including the basest senses. They are called upon by what? By light and the variations in light depending on the hour and the season. Faulkner’s descriptions . . . if you said to me: what is the fundamental object of the description? That is, that which can only be described—anything can be described, but it can also be something other than described. But what can only be described? Light, states of light. It’s precisely because they can only be described that they are so hard to describe.
Those who know Faulkner know very well that, to my knowledge, in the history of literature no author can match him for knowing how to describe, sometimes over a number of pages, a nuance of light that falls on a group of things. And the things are seen. But visibility is not the things that are seen. For the things that are seen are also heard, smelled, etc. Obviously, all the senses are called upon in Faulkner. Things are seen, smelled, handled, fondled, etc. All the senses are worked with a certain force . . . but with all the more force given that, all together, they are drawn toward the light. Light in August, they are drawn toward the light in August. They are drawn toward the light of five o’clock in the evening. Thus, visibility emerges, thus things open up and visibility emerges. There’s no author of light like Faulkner. And this is perhaps linked to the South, to the South of the US, since that is Faulkner’s setting—I’m specifying for those who do not know Faulkner—it’s perhaps linked to the light in the South, the light of August in a Southern state. Yeah, perhaps . . . What accounts for his having this genius for light? Okay, so, what does Faulkner do? Faulkner is the one who really makes multi-sensorial things emerge, not the supposed primacy of a sense, namely sight, but pure visibility. The cruel side of visibility, its absolute rawness. And it’s this light-being that gathers in each Faulkner novel, such that it’s fair to call the Faulknerian corpus the ‘there is of light’ as it falls on all of Faulkner’s novels, or on a particular novel, or on a particular page of a novel.
And at the same time, there are Faulknerian statements. And these Faulknerian statements, everyone knows that they emerge when? When Faulkner has, as the second pole of his genius, broken up the sentences, propositions, and words by relating to a whole of language that will blend them together. And what will the statements be? Faulknerian statements will be grasped at the point where one same name refers to two different persons, or else one same person to two different names. And it’s these genealogies, of these Southern families, in Faulkner . . .
And if I may add, in order to make it all coherent—but there’s no need—and what plays out in these two corpuses, the corpus of sentences and the physical corpus? What plays out at the level of Faulknerian statements, as at the level of Faulknerian visibilities? The answer is very simple: what plays out are abominable power relations, namely: the decadence, the decadence of the South, the degeneration of these powerful, old families—everyone who has read a bit of Faulkner knows this. Sites of power that are both consuming and consumed. And all this, the entirety of these statements linked to the sites of power astir within them, what does that yield? It yields—and here I find myself amid the best-known passages in Faulkner—it yields the famous story, full of sound and fury, told by an idiot. The story told by an idiot is the ‘one speaks.’ All that needs to be added is that not only is it told by an idiot, it’s seen by a moron. And the ‘seen by a moron’ is visibility, just as the ‘told by an idiot’ is statability [l’énonçabilité]. The statement only ever has an idiot for a subject, that is, a position as the ‘one’ of ‘one speaks.’ Visibility never has for a subject anything other than a ‘one’ in ‘one sees,’ that is, a place in light-being.
Okay, very good. Good, good, good, good, so then what? Well then, we thus agree, we’ve extracted everything we could from the parallelism. Now we have to backtrack. Let’s admit that we now have a vague idea of what a visibility is, by contrast to a seen thing. That’s one more reason to go back. Now we can’t put it off any longer, we’ve got to say: what is a statement? How is a statement neither like a word, a sentence, or a proposition? We have to try. I mean, in fact we have a vague idea. Having reached this point, we have a vague idea. Statements actually are not sentences, propositions . . . but how so? How so? How so? We must not give up. As long as we’ve not got a possible answer, we must not give up. So, we’ll search. But how, alright . . . are you alright? [Deleuze laughs] I’m not asking you that out of concern for your health, I’m asking that because . . . we’ll rest, okay, a little bit. But ten minutes, alright? No more than ten minutes! What time is it? [Response: 20 to 11] … [Interruption of the recording] [1:17:00]
… Are there any questions that would mean I couldn’t go on? No questions? One small question . . . No, no questions?
A student: [Inaudible comment]
Deleuze: Yes? A little question!
The student: You alluded to light in Heidegger . . .
Deleuze: Ah, yes, yes, well, that, that comes later, a parallel with Heidegger. Because, yes, yes, so, not right now! Another question? [Laughter] No other questions?
Good, well, let’s go, then. We have to move on since there are no questions. So, listen, now: I believe—it’s in the category of ‘I believe’—so, handle that how you wish—even so, I believe one can try to assign the difference between statements, on the one hand, and the group of “words, sentences, and propositions,” on the other, to four levels. Once we’ve looked at all four, we won’t be able to take anymore—but we won’t look at them today! Four levels. There you have it. And, so, that’s it! [Laughter]
So: the first level. I’m looking for the least occasion to . . . so . . . No? No questions? [Laughter] The first level. [Pause] It’s not only logic that deals with propositions. In a certain way—take care to number my levels, okay, because otherwise . . . in a certain way linguistics deals with propositions. What is a proposition in the linguistic sense? I would say that linguistics extracts propositions starting from sentences. But what do I mean? Oh, I mean something very, very simple. I mean: a sentence is what linguists call, let’s assume, speech. Written or oral speech. But speech—you can tell right away that I’m referring to the classic linguistic distinction between language and speech [langue/parole]. Speech is always a de facto mixture [un mélange de fait], speech is a mishmash, speech is full of stuff.
A de facto mixture, what does that mean? What does it mix? It mixes very different systems. When you speak, you mix very different systems. What does ‘a system’ mean? Linguists try—and this is their primary scientific task, they say—to distinguish systems of language [langue] within speech [parole]: a system. How is a system defined? In two ways: its overall homogeneity [homogénéité d’ensemble]—that is, the homogeneity of the formation rules, its homogeneity overall—and the constancy of certain elements. Constant elements, overall homogeneity. It’s abstract.
Example: Spoken American[6] — an example that I invoke in all the greater good faith given that I do not speak it — numerous linguistic systems correspond to spoken American. Let’s consider two. What I’m saying is said constantly by linguists, but, I specify, is maintained by [Noam] Chomsky. So, if you will, from [Ferdinand de] Saussure to Chomsky, linguists tell us: scientific work on a language [langue] presupposes that one already would have extracted homogeneous and coherent systems that will be the object of scientific study. It’s not speech [parole] that can be studied scientifically, or, at least, it cannot immediately be so studied; it can be studied only afterwards. What matters at first is determining homogeneous and coherent systems.
An example: From spoken American, I take two systems. One will be called ‘Standard American,’ the other, ‘Black English’,[7] the language of Black Americans. That there are overlaps, encroachments, is not the question. One can define two systems. For example, the rules for the past participle are not the same. Okay. When I say that the linguist extracts by and he extracts propositions from sentences, I mean that he starts from a de facto mixture [un mélange de fait]—speech—and he extracts systems each of which is homogeneous and coherent. An ‘American Standard’ system, and a ‘Black English’ system, to take only two systems. It is such systems, and only such systems, that will be the object of a scientific study. The search for the constants and rules of homogeneity. Is that clear? Good.
That’s the first thing that matters to me. I would say that: a proposition in the linguistic sense is what is part of one or another system. You see that the linguistic proposition is not exactly the same as the sentence. The sentence mixes systems, the linguistic proposition belongs to a system that is definable by the homogeneity of its rules and the constancy of its elements. Okay. To me, that’s enough for now. I’m still on my first point.
To me, that’s enough for now. I seem like I’m thinking about something else entirely. I was telling you: a foundational book on statements about sexuality is the great classic by [Richard von] Krafft-Ebing: Psychopathia sexualis. For those of you who have not read it, I cannot recommend it to you too highly since in it you’ll learn the secret of all the perversions, including an extraordinary perversion, alas since fallen into obscurity, namely, the perversion of the braid cutters, [Laughter] which at one point, was a great hit in the Metro. They were base individuals who slid up behind young girls with lovely braids and cut off the braids of these young girls. And I say that because this was, when I read Krafft-Ebing, with enthusiasm and, simultaneously, the purest moral horror, [Laughter] I was stunned by the fact that Krafft-Ebing, who had seen it all, come across everything, he’s an expert witness before the courts, all that, and he maintained an imperturbable composure in the face of the vilest things, cases of sadism that will make you shudder, or else all of their masochists, all that, one can barely read it because it makes you so, so . . . it’s unbearable, or else people will exhume corpses, abominations, just horrors, horrors, horrors.
So, he’s seen everything, and then comes a moment when he cracks. Now that’s tremendous. The psychiatrist crumbles. Which goes to show that one can never say, “I can withstand anything.” He withstood everything, the disembowelments, the removal of viscera, all that, everything: you name it, and he’s perfectly fine, it’s even as if he’s recounting trivial things, all that just goes without saying for him. Then, all of a sudden, he completely loses his grip. He’s talking about the braid cutters, [Laughter] you don’t know what’s going on at all anymore, and Krafft-Ebing starts to say: such individuals—okay, I’m quoting by heart, it’s forever in my heart—such individuals are so dangerous that one must at all costs remove them and take away their freedom. For the sadists who kill, for the Sargent Bertrand who exhumes corpses, he had nothing but the cold words of the man of science. For the little girl and her braids, he crumbles. He says: this is heinous. It’s very curious, no? It’s very, very curious. Now that’s people’s thresholds.
People always have thresholds: you’ll see a terrific sadist suddenly be a masochist and then he bends back a little fingernail, and he crumbles, whereas the previous evening, he had horrific burns administered to him, it turns out that this, he couldn’t stand. I know someone—all this is an ethics course, I’m turning it into . . .—I know someone—and I understand this very well—who withstands, and due to his very occupation, he is forced to, he stands the dead, the spectacle of the dead, of death, in the saddest and most dreadful conditions. But there is one thing he can’t stand, the image of a boat going down. I don’t know whether you’ve ever seen images of boats going down, you see that often at the movies, and you think you get it, because something about it is so moving, it’s at the very edge of what’s bearable. The way a boat goes down, it’s as if what we had was a death even more terrible than any death of a person, it’s this kind of collapse, this collapsing . . . and so, right there, he cracks.
Well, the great Krafft-Ebing cracked at the sole thought that one could cut a young girl’s braids. And yet it doesn’t hurt very much . . . Anyway, that’s what we call a digression, what I just did. So, the great Krafft-Ebing, I already told you, what is a statement in Krafft-Ebing? It’s very curious, it’s a statement astride two languages. He writes in German, and in his German sentence, as soon as what he says offends modesty, he says it in Latin and in italics. To the extent that you can’t read Krafft-Ebing unless you’ve done Latin, or at least you’ll miss something. Okay, so I would say that typically Krafft-Ebing’s statements—and here I’m choosing my words carefully—Krafft-Ebing’s statements are astride two systems. I’m not saying: Krafft-Ebing speaks German at times and Latin at other times. I’m not talking about a de facto mixture, I’m talking about a combination in principle [une organisation de droit]. Krafft-Ebing’s statements constantly pass from the German system to the Latin system and from the Latin system to the German system. You’ll say: this is something of a special case. Let’s go on.
I believe that Foucault is rather close to—and since I’m not even sure that Foucault knew this author, the inverse as well—an American linguist, a specialist in what he himself termed ‘sociolinguistics,’ by the name of [William] Labov. I believe that it’s pronounced like that, I’m not sure. L A B O V, okay? Labov, yes? Labov conducted studies that seem very, very interesting to me, I say, uhm, you will understand why it seems close to Foucault, to me. He conducted studies on, for example, a young, black American who is explaining something, and Labov wonders, for example, how many times, over a short period—two minutes, for example, he’s explaining a game, for instance a very complicated black kids’ game in Harlem—he wonders how many times in two minutes the kid switches from Black English to Standard English and the reverse, with, as Labov puts it—and this is very interesting, it seems to me—with broad swathes of indiscernibility, that is, of segments of sentences that one could just as well tie to Black English as to Standard American. At times it’s one, at times it’s the other. At times, one wants to relate them to Black English, at other times to Standard American. In other words, the young black child constantly slides, that is, moves from one system to the other. He crosses over between systems [il fait une transversale de systèmes]. His statements cross over between systems. He constantly passes from one heterogeneous system to another.
If you’re following me, you must sense that we’re on to something here. I’m sticking with these two examples: Krafft-Ebing and Labov. Two very, very different examples. But think: what do you do when you speak? You constantly cross between systems. You see, even . . . if . . . this is why linguistics is nothing if it doesn’t have a pragmatics. I mean, even, I’ll take my miserable example, and make it quick: okay, I’m fed up, I start to tell a thing about the braids of . . . it’s not the same system as what I was saying before . . . I’m crossing over [je fais une transversale], as a way of gaining time, okay. Uh, or else, no! Or else I’ve got a strong pedagogical concern which means that I say to myself: they’re tired, they can’t follow well anymore. And so, I try to become lively . . . Nothing happens—but no matter. Although earlier I was referring to one homogeneous philosophical system, here I am indulging in a system, a system of tricks. Okay, okay, it’s worth what it’s worth. I crossed over . . . Good. In life, you don’t stop. You don’t stop. Okay.
What does Chomsky tell us? Chomsky says: ah, yes, but everyone knows this, he says. He says everyone knows this, that’s the situation in fact, but never was a science constituted on fact. A science must cut out its systems from the facts. Science begins only . . . Of course, when you speak, says Chomsky, you mix systems together, but science can be a science [only] of systems separated from each other. You understand? It’s somewhat like for physics: of course, perception mixes all sorts of systems, but as for scientific physics, it can be established only if it separates heterogeneous systems so as to constitute homogeneous systems. You see? That’s Chomsky’s position.
The Foucault-Labov position consists in saying: well, Chomsky understands nothing at all. He understands nothing at all. The problem is not at all one of fact. Of course, in fact one mixes. But the problem of principle [le problème de droit] is: are there in principle any homogeneous systems? Are there any homogeneous systems? Does ‘homogeneous system’ mean something in linguistics? And what if in principle there were only passages, there were only variations, there were only crossovers [transversales] between systems? Then, everything changes. Namely, what has a value in principle are no longer propositions, each one resituated within the coherent and constant, the homogeneous and constant, system—but . . what will it be? What counts is the statement. And how is the statement defined as different from the proposition? Every statement is the actual passing [passage en acte] from one system to another, as opposed to propositions which, for their part, belong to a given system.
Krafft-Ebing’s statements are the set of rules according to which he constantly passes, in the same sentence, from a German segment to a Latin segment. The statements of the young, black American child from Harlem are the set of rules by means of which he constantly passes from a segment of Standard English to a segment of Black English, and the reverse. In other words, the rules for a statement are the rules of variation. The statement is the linguistic instance [l’instance linguistique] that comprises variations, that is, transitions [passages] from one system to another. The statement is thus opposed to the proposition. And there will be no statement unless there is a transition [passage] from one system to another system that is heterogeneous to it. Which amounts to saying—and here you’ll recognize Foucault—which amounts to saying that the statement is not a structure, the statement is a multiplicity. By ‘structure,’ we mean the determination of a homogeneous system in relation to its constants. By ‘multiplicity,’ we mean the totality of the transitions [passages] and rules for passing [règles de passage] from one system to another system which is heterogeneous to it. However, there are no homogeneous systems, there are only transitions [passages] between heterogeneous systems.
Thus, if you wish to extract—here, this is very concrete—if you wish to extract the statement that corresponds to a sentence, here’s what you have to do: do not look for the linguistic propositions that correspond to the sentence, but do something else altogether: determine which transition [passage] from one system to another the sentence carries out, in both directions, and how many times it does so. It’s at that point that you’ll have a statement. Not only do statements come by the multiplicity, but each statement itself is a multiplicity. There is no structure, there are only multiplicities.
So, to me, that’s enough for the first level, I wouldn’t ask for more; I don’t know whether you’d like more, I could try to say more, but this seems to me already to be something very, very practical, which shows the extent to which what he calls a statement has no match in the propositions that linguists study. A linguistic proposition is by nature defined by its belonging to a homogeneous system defined by constants. A statement is exactly the opposite. Thus, we are all Krafft-Ebings, even if we speak neither German nor Latin, since we are constantly transitioning [de passer] . . . You’ll say: but in the case of Krafft-Ebing, it’s very simple, it’s for reasons of modesty, that is, reasons which have nothing to do with language. And that’s indeed what a linguist would say, but that’s idiotic! That’s completely idiotic. Because you can always attribute reasons of modesty to what is external to language, but they’re also variables of the language. It’s insofar as he speaks, and it’s insofar as he produces statements, that Krafft-Ebing composes them out of German and Latin. Moreover, this is the case for us all, we are always astride several languages. That’s good: we are all bilingual. And even further: we are multilingual, it’s just that we don’t know it. You’ll say that I’m using language in an illegitimate way: not at all, I’m using it in the strictest sense: a homogeneous system defined by constants. Phew. There you go, a first point that’s very clear. No questions? No question, no question.
The second level. And here, it’s obvious, there is a choice to be made. I mean, you can’t hold both at once, you can’t say: on a certain level, it’s the linguists who are right, and on another level, it’s the multiplicity. No, you can’t do that. You can’t hold the two positions. You can’t hold the two positions. If you believe in multiplicities, there is only one thing you can say, which is: each segment of what you say, no matter how small it is, each linguistic segment, is a transition [passage] between two heterogeneous systems. Never will you find any segment whatsoever that belongs only to one system. Thus, if you will, the theory of multiplicities, it seems to me, is radically opposed, in this sense, to structuralism. And Foucault is right, he’s entirely right to say, already in Archaeology of Knowledge, that he is not structuralist.
I believe that, actually, he is among those who believe in a doctrine of multiplicities—whereas multiplicities have nothing to do with structures. They’re something else. Why? Because, once again, they are rules for passing [règles de passage] between heterogeneous systems, and not at all formation rules for homogeneous systems. So, you’ll say: in order for there to be transitions between heterogeneous systems, there must surely be systems each of which is homogeneous? No, that’s not true. If there are only transitions between heterogeneous systems, this means that for its part the idea of a homogeneous system is an abstraction, and not only an abstraction, but an illegitimate abstraction. Only the transition matters. There you have it; hence the second level.
Okay, the second level: This time, I’m considering the sentence. Well, the sentence refers to a subject, but the subject to which it refers is the subject of enunciation [le sujet d’énonciation], bizarrely, incidentally, called “of enunciation.” A sentence has a subject of enunciation, which is not to be confused with the subject of the statement. If I say, “the sky is blue,” the subject of the statement is “the sky” and it’s not the subject of enunciation.
What is the subject of enunciation of the sentence? It’s the sentence insofar as it refers to a grammatical person. What is a grammatical person? The grammatical person is “I.” “I” is the subject of enunciation of the sentence. Any “I” whatsoever? No. There are “I”s that are grammatical persons in appearance only. If I say, “I am walking,” there is no difference in nature between the sentence “I am walking” and the sentence “He is walking.” In one case, “he” is the subject of the statement, in the other case, “I” is the subject of the statement. Thus, in the sentence “I am walking,” “I” is not the subject of enunciation, it is only the subject of the statement, and interchangeable with “he.” [Pause] On the other hand: I say, “I swear it,” “I swear it”—this time the “I” is not of the same kind as the “I am walking.” Why? Because I don’t walk by saying “I am walking.” I can walk and say, “I am walking,” but they’re not the same thing. Whereas, when I say, “I swear it,” I swear by saying “I swear it.” That’s the subject of enunciation, the true linguistic person. This is the true linguistic person, this is the first person.
What is this “I,” this true linguistic person? It’s what is called, what linguists call, a referential “am,” or if you prefer, a shifter. As they say, it initiates discourse. What is its very strange property? It’s that the “I,” the subject of enunciation, designates neither a person, nor a concept. Rather, neither some thing, nor a concept. Neither someone, nor a concept. What does it designate? It designates solely the one who says it. The one who says “I” is “I.” “I” is the one who says it—that’s the formula of the referential “am.” It initiates discourse. Very well. In other words, the first person is the subject of enunciation by means of which, or to which, the sentence refers. This subject of enunciation is the “I” as first person who is irreducible to the third person. Irreducible to the third person. The “I” of “I am walking” is, on the contrary, perfectly reducible to the third person. What I have just summarized, in a very, very abbreviated way, is a famous theory, in France, at any rate, which you find all over. But I have summarized it particularly from the point of view of [Émile] Benveniste in Problems of General Linguistics,[8] since some of you who have studied some linguistics have recognized in what I’ve been saying a theme that is very close to what the English and Americans have called “speech acts” . . . [Interruption of the recording] [1:52:33]
Part 4
… Objection: Aren’t there languages with no first person? Benveniste devotes—who is an excellent linguist, so, here, I won’t . . .—Benveniste says that, even when the first person does not appear, its place is there. He refers to Japanese — uh, will you confirm this? Very good. [Deleuze is probably speaking to Hidenobu Suzuki who is recording the session] — It goes without saying, on this point, that in a sentence, this “I” as the subject of enunciation can of course be implied. There’s no need to quote me sentences that are not of the “I swear it” type. There are obviously plenty of those. And if it’s implied, that makes no difference: the sentence refers to a subject of enunciation that is implied or explicit. Good.
In other words, I would say: this subject of enunciation is an intrinsic constancy, it’s an intrinsic constant. And here, you’ll note that anyone at all can take the place of this linguistic “I.” “I” is the one who says it. Indeed, I’ll say “I,” but you’ll say “I” later on, or you’ll say “I” at the same time. “I” is the one who says it. Hence, the formula for the sentence, here, is: intrinsic constant, extrinsic variable. The intrinsic constant is the subject of enunciation, the referential “am,” the shifter. The extrinsic variables are the infinity of individuals who can say “I.” Alright? I would thus define the sentence by its intrinsic constant, the variables being necessarily extrinsic. This is the form of the “I” in linguistics. [Pause]
Very well. And so, perhaps all this is valid for sentences, but that shows that sentences, well, they’re not anything very interesting. Because—and here I’m hooking back up with Foucault—because, because what? Because at the level of statements, you’re going to see that it’s something else entirely. A statement indeed refers to a subject, right, no problem there. It refers to a subject. Ah, but things get complicated because not only does it refer to a subject, but it runs the risk of referring to lots of subjects; it rather has too many of them. You can sense already that the “I” will not be suited to expressing the subject of the statement. It has too many subjects. Because, on the one hand, you see, the subject is highly likely to vary in nature from one statement to another.
The second point: for one same statement, it is highly likely that it has numerous subjects, which of course are not reducible to a “we”—numerous heterogeneous subjects … yes, so let’s start. Numerous . . . The subject is very different, depending on the statements. Well, yeah. [Pause] So, here is a curious text, taken from a lecture, “What is an Author?” [1969] Foucault says: does a statement necessarily have an author? He says: no, a statement may have an author. There are certain statements that have an author, notably, literary statements, for example. Someone tells me something, and I say, “who’s that from?” And they answer: “that’s from Victor Hugo.” There is an author. So, certain statements have an author as their subject of enunciation.
But there are statements that have no author. For example, a letter I write. Am I going to say, I am the author of the letter? Sometimes, yes. I’ll say “I am the author of the letter” if it’s an anonymous, criminal letter. In that case, “author” no longer means “literary author,” it means “author of the crime.” An anonymous letter has an author: auctor delictis! See that? I just did what Krafft-Ebing does, I just produced a statement. As Foucault says, it’s not hard to produce statements [Deleuze laughs], we produce them all the time and yet they are rare, he says, in fact, because . . . the two things are very consistent . . . well, no matter.
So, apart from that, a letter has no author! Ah, right, it has no author, it has a signatory. Is the ‘author’ function the same thing as the ‘signatory’ function? No. If I write to a friend: “I can’t make it to the meeting, cheers,” uh, I can’t say that I am the author of the letter, I am the signatory to the letter. But what if I am Madame de Sévigné . . . ? Ah, here things become more complicated. I am a signatory in relation to my daughter to whom I am writing, my cherished daughter, but I am also an author, since my daughter has my letter sent round in literary circles, saying “Have you seen the letter my mother just sent me? You won’t believe how good it is!” And since public readings of Madame de Sévigné’s letter take place, she is an author. This is how one same statement has two subjects: Madame de Sévigné as an author, Madame de Sévigné as a signatory—those aren’t the same. Good.
Let’s take a case like [Marcel] Proust, who is cited by Foucault. The first sentence of Remembrance of Things Past: “For a long time I used to go to bed early.”[9] Foucault asks a very simple question—but I think we are now prepared to understand it: Is it a sentence? It stays the same. Is it the same statement? If I am the one who says it, I could have happened to say it by chance one day, I said to a friend, just off the cuff, “oh, you know, for a long time I used to go to bed early,” without knowing that it was in Proust. It’s not a very, very complex sentence . . . I’m not an author, I am, at that moment, the speaker of the sentence. But when Proust writes it as the first sentence of Remembrance of Things Past, he is the author of the sentence. Does the sentence refer only to an author? No, it refers to a narrator, who is not the author. The sentence has two subject positions: the author, the narrator.
A letter has a signatory and not necessarily an author. And Foucault continues: a contract has a guarantor—that’s actually the technical term—it doesn’t have an author. A text that you read on a wall in the street has a scriptor, which is not the same thing as an author. You see, there’s a huge, there’s a huge . . .: author, narrator, scriptor, signatory . . . at any rate, the list is wide open, you can make some up, you can make up plenty of them. And I stress that in my examples—I’ve already gone over to the other case, namely: one same statement that refers to a number of types of subjects. Madame de Sévigné’s statement, Proust’s statement, which goes by way of an author and a narrator. Or else—for those who were here in other years, we treated this at some length—the example of free indirect discourse. In free indirect discourse, you have a short-circuit of two subjects that occupy completely different positions. I’ll repeat very quickly for those who were not here, so they can understand, since, here, this is brilliant.
A statement of free indirect discourse is very interesting. It’s precisely a statement that you place in an enunciation that does not depend on the same subject of enunciation. If you will, it’s: “I tell her not to take this trip. She’ll take every precaution and doesn’t need any advice from me.” You see, this form that you find very frequently in the novel, is free indirect discourse because indirect discourse would be: “I tell her not to take this trip. She replied that she’ll take every precaution and doesn’t need any advice from me.” And here there’s a kind of break. In “I tell her not to take this trip” . . ., there is no “she replied that . . .” There is: “ … She’ll take every precaution, etc.” The subject of enunciation, “she,” slips right into my statement, of which I am the subject. There is a sort of slipping of one subject of enunciation into another subject of enunciation. Free indirect discourse is a very beautiful example.
So, the linguists, they are . . . to account for free indirect discourse, they occasionally rig together fascinating theories. It’s a very, very beautiful problem. Once we specify that when they are stupid, they say: free indirect discourse is a combination of direct and indirect discourse . . . That’s idiotic, really, that’s of no interest. And, plus, it’s not true. Grammatically, it’s not true, since there are grammatical tenses in indirect discourse that do not match any tenses from either of the two. There is thus an originality to free indirect discourse. You see: a subject interferes [il y a immixtion d’un sujet]. Free indirect discourse is like a vampire. One subject of enunciation comes and vampirizes another. A very beautiful case. It’s a case of one statement that refers to two subjects of enunciation. Good.
Which amounts to saying what? Well, all these subject positions, I return all the more to Krafft-Ebing . . . with him, it’s yet another thing, one could extend Foucault’s list. Krafft-Ebing’s statements do not refer to an author, they refer to what? To something very, very special in literature, it’s what is called a compilation, an anthologist. That’s a very old thing, the anthologist. It’s fortunate that there have been some. Since it’s something that in my view develops with the Greeks and Romans. I say it is “fortunate” that there have been anthologists because since we no longer have many texts from the Greeks and Romans, a great portion of the few we have come from anthologists. So, an anthologist, for example, a anthologist famous among Romans, a very, very useful one, it’s a source for everything, is Aulus Gellius. Aulus Gellius made a book that is composed of short chapters on: under what circumstances did the tragic poet say a given thing? And he quotes five verses from a lost tragedy. You see, it’s a sort of compilation. With Montaigne, there is also something like this, even though he is not an anthologist, there is a kind of compilation in effect. They’re very important, the anthologists, since thanks to them, we know plenty of things. And so, I would say: Krafft-Ebing is an anthologist. But Krafft-Ebing’s statements thus refer to a subject position, that is one as an anthologist.
What does all this mean? I’ll quickly finish this second point. I would say that, contrary to sentences that refer to a formal constant—to a first person, to an ‘I’ as first person or as the subject of an enunciation—the statement refers to variable subject positions, at times to several for a single one. And—it will all be clear to you—all of these subject positions are ordered in the cohort, in the long procession, of a ‘one speaks.’
They are the figures of a ‘one’ that are deeper than any ‘I.’ Here, Foucault converges once again with [Maurice] Blanchot, who, to my knowledge, went furthest in the direction of deposing linguistic personology, denouncing grammatical persons in favor of an ‘it’ or ‘one’ that is deeper. That is, what we have is the anti-Benveniste. Benveniste denounces the third person as a false person; Blanchot brandishes the ‘one’ as the expression of the non-person, and it is the non-person who is the true subject of the statement.[10] So much so that all subject positions, all these variable positions we’ve just seen, one by one come to characterize the figures of the ‘one’ without breaking the anonymity of this ‘one.’ This was Foucault’s dream, when he said: “to take up my place in an anonymous murmur,” in “The Discourse on Language.”[11] That is, the proper noun is no more than a figure for this ‘one speaks:’ Krafft-Ebing, Madame de Sévigné, all of them, all subject positions line up as the variables of a ‘one speaks.’ You understand?
This amounts to saying what? It amounts to saying, we saw earlier, that the sentence was defined by an intrinsic constant and extrinsic variables. The intrinsic constant was the ‘I’ as the subject of the enunciation. The extrinsic variables were all of the individuals who could say ‘I.’ I would say: the statement, on the contrary, is defined by a set of intrinsic variables. It’s the idea of an intrinsic variable.
This connects very well to my first level. My first level held: the statement is defined by rules for passing between heterogeneous systems. My second level says: the statement is defined by intrinsic variables, namely, by the set of subject positions to which it refers, each subject position consequently being a figure for the ‘one.’ It is an absolute anti-personalism. There is neither intrinsic constant, nor extrinsic variable. There are only intrinsic variables of the statement. Here, once again, this is very close to Labov. Labov, too, devises a theory of the intrinsic variables of language.
Well, then, we have worked well. So, I’ve come to the third level. Now you should be able to guess what the third level is. I’m telling you so that you’ll think about it: this time, we’re coming to the proposition. We are told that the proposition has a referent, that is, that it refers to a state of affairs. The state of affairs may or may not fulfill the reference. I say, ‘The sky is blue.’ The proposition refers to a state of affairs: ‘blue sky.’ The sky could be black. In that case, the reference of the proposition is not fulfilled, is not realized. That doesn’t prevent the proposition from having a reference. I would say that in the case of a proposition, there is reference to a state of affairs—that’s the constant, that’s the intrinsic constant. And the state of affairs is there or is not there to fulfill, to realize, the reference—that’s the extrinsic variable. Fine. [Pause] For a statement, this is not at all the case. For a statement, it’s entirely different. [End of the session] [2:12:11]
Notes
[1] “The Life of Infamous Men”, 1977, transl. Paul Foss and Meaghan Morris, in Michel Foucault: Power, Knowledge, Truth (Sydney: Feral Publications, 1979), p. 88; ‘La vie des hommes infâmes’, 1977; Les Cahiers du chemin, 29 (15 January 1977), Dits et Écrits III (Paris, Gallimard, 1994) 237-253.
[2] Page 27 in the original.
[3] “Givens” are also “data”, as données.
[4] The Birth of the Clinic, p. 165, trans. adapted; Naissance de la Clinique (Paris: PUF, 1963), 169.
[5] The Birth of the Clinic, p. 165, translation adapted.
[6] That is, American English.
[7] Deleuze uses English here.
[8] Problèmes de linguistique générale (Paris: Gallimard, 1963).
[9] Marcel Proust, Remembrance of Things Past, Vol. I, Trans. C.K. Scott Moncrieff and Terence Kilmartin (New York: Vintage, 1982), p. 3.
[10] On Blanchot as the anti-Benveniste, and more generally on the linguistic opposition between them, see session 2 of the seminar on Anti-Oedipus and other reflections (June 3, 1980).
[11] Michel Foucault, “Appendix: The Discourse on Language” in The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language (New York: Pantheon, 1972), 215-239. Trans. A. M. Sheridan Smith. “The Discourse on Language” is a translation of L’Ordre du discours (Paris: Editions Gallimard, 1971), trans. Rupert Sawyer.
French Transcript
Dans la conférence du 12 novembre 1985, les sujets de discussion comprennent: la définition d’une énoncé dans la philosophie de Foucault; le pouvoir comme strictement immanent au savoir; les foyers du pouvoir et de la résistance concernant la sexualité au XIXe siècle; l’essai de Foucault La vie des hommes infâmes; énoncé, visibilité et le corpus; visibilités comme complexes d’action et de réaction; l’artiste français Robert Delaunay; Naissance de la clinique de Foucault; les régimes de visibilité et le pouvoir; énoncés et visibilités capturées; Richard von Krafft-Ebing et sa Psychopathia sexualis; le linguiste américain William Labov, des systèmes hétérogènes et passages dans la phrase; énoncé et multiplicités; linguistique, énonciation et les positions des sujets; le discours indirect libre; le linguiste et sémioticien français Émile Benveniste; Blanchot, le destitution de la personnologie linguistique, et le on et le je; et l’énoncé se définit comme variable intrinsèque. Deleuze passe aussi beaucoup de temps au milieu de la conférence sur la lumière. Parmi les sujets abordés dans cette discussion particulière, il y a: que la lumière n’est pas un milieu physique ni Newtonienne, mais qu’elle est première, une condition indivisible, un a priori; le sens de la lumière de l’écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe; cette lumière tombe sur le corpus et le capture; la lumière au XVIIe siècle et l’œuvre de l’artiste espagnol Diego Velázquez; les visibilités et la peinture comme des lignes de lumière; que le on voit est un état de lumière, pas des choses; les luministes de la littérature; et les énoncés et la lumière dans l’œuvre de l’auteur américain William Faulkner.
Download
Gilles Deleuze
Sur Foucault
1ère partie : Les formations historiques
4ème séance, 12 novembre 1985
Transcription : Annabelle Dufourcq (avec le soutien du College of Liberal Arts, Purdue University) ; l’horodatage et révisions supplémentaires, Charles J. Stivale
Partie 1
… à penser de Foucault. Ce point revient à demander : mais qu’est-ce que c’est, au juste, qu’il appelle un énoncé ? Alors, à charge pour moi, à la fin de ce passage, à charge pour moi d’essayer de donner une réponse, une réponse où, là, il faudra que vous me coinciez si cette réponse n’est pas claire et concrète. Car la question est bien : qu’est-ce que c’est qu’un énoncé en tant que l’énoncé ne se confond ni avec des mots, ni avec une phrase, ni avec une proposition ?
Donc sur ce point, il faudra que vous soyez très sévères : si je ne donne pas de réponse, ben, il faudra dire : ça ne va pas tout, ça ! Moyennant quoi, je me donne le droit d’aller très lentement, c’est-à-dire de faire les détours qui me semblent [1 :00] nécessaires, parce qu’encore une fois, c’est une question qui me semble compliquée. Et L’Archéologie du savoir est sûrement un livre difficile. Alors je me donne le droit de certains détours, notamment pour répondre à une question que l’un d’entre vous me pose. Et, cette question, je la lis pour que vous la reteniez et, en effet, je crois qu’elle peut se poser.
La question est la suivante : « On peut penser les choses sans qu’il y ait une visibilité, il n’y a pas d’implication entre les deux » — dit celui qui pose la question – « en revanche on ne peut pas penser des mots sans qu’existent des énoncés » — tout ça cela ne me paraît pas sûr, hein, j’essaie de… – « même si leur source première n’est qu’un “on”, on [2 :00] ne peut dire des mots qui ne soient des énoncés, si bien que la cause des énoncés serait les énoncés eux-mêmes ». Vous voyez : je retiens au moins de la question : on peut parler de choses indépendamment de visibilité, on ne peut pas parler de mots indépendamment d’énoncés. A mon avis, non, ça n’irait pas si c’était ça. Mais c’est compliqué d’essayer de se débrouiller là-dedans. Donc, notre question fondamentale, toujours dans la rubrique « mais qu’est-ce que ça veut dire savoir ? », c’est cette sous-question « mais qu’est-ce que ça veut dire “énoncé” », et nous savons juste pour nous repérer que l’énoncé encore une fois ce n’est ni mot, ni phrase ni proposition. Bon, alors, où est-ce que nous en étions ?
C’est là que j’éprouvais, la dernière fois, le besoin de [3 :00] commencer par un détour, me disant que, peut-être, l’autre moitié, l’autre aspect de la question, à savoir la question de la visibilité, pouvait nous donner des lueurs sur la question principale de l’énoncé. Et, la dernière fois, on en était à peu près à ceci. Je disais : vous voyez, au point où nous en sommes, quant à cette histoire de l’énoncé, la méthode de Foucault consiste à dire : quand vous posez un problème, quel qu’il soit, donnez-vous un corpus. Vous partez d’un corpus, un corpus bien déterminé, d’après le problème que vous vous posez, d’après la recherche que vous faites. [4 :00] Vous comprenez : à ce niveau, il ne se donne pas l’énoncé, ce serait très fâcheux — il y aurait cercle vicieux — il ne se donne pas d’énoncé, c’est un corpus de mots, de phrases et de propositions simplement. Ce ne sont plus simplement des mots, des phrases et de propositions, puisque c’est des mots, des phrases et de propositions saisis en tant qu’ils forment un corpus. C’est donc déjà un premier point dans sa méthode. D’où la question sous-jacente — on l’avait vu la dernière fois — « mais, comment on constitue le corpus ? ». Comment on constitue le corpus ? Essayez de voir que, déjà, cette question est très compliquée. Car, [5 :00] si je dois commencer à constituer un corpus pour arriver à comprendre ce que c’est qu’un savoir, il faut que les moyens que j’emploie pour constituer le corpus ne présupposent rien d’un savoir. Sinon ça n’irait pas la méthode.
Mon problème, en effet, depuis le début, c’est « qu’est-ce que le savoir ? ». Et je dis, par exemple, savoir, c’est énoncer. Bon, comment trouver des énoncés ? Je pars d’un corpus de mots, de phrases et de propositions. Là-dessus : objection. « Comment tu constitues le corpus ? ». Si, pour constituer le corpus, je fais appel à quoi que ce soit qui présuppose un savoir, ça ne va pas. [Pause] [6 :00] Si bien que, dans les premiers livres de Foucault, vous ne trouverez pas des règles d’après lesquelles il constitue ses corpus. Vous ne trouverez pas. Bien plus, il ira jusqu’à dire : oh, moi, je ne fais que des fictions, mes corpus, c’est des fictions. Ce qui revient à dire : je suis une espèce de romancier.
Alors, il n’a pas tort. En même temps, on sait bien que ce n’est pas vrai et que, dès ses premiers livres, il avait déjà une idée qu’il ne développera que plus tard. Mais qu’est-ce que c’est, cette idée ? Si, alors, je me donne les livres suivants, la réponse éclate et, pour nous, est satisfaisante au moins provisoirement, quitte à ce que, plus tard, cette année, on l’étudie directement. Mais, si je me réfère déjà à cette réponse, ces quelques [7 :00] critères de constitution du corpus, une fois dit que ces critères ne doivent pas empruntés à un savoir, ils seront empruntés à quoi ? Ils seront empruntés au pouvoir. C’est-à-dire, un problème étant donné, je constitue le corpus correspondant dans la mesure où je détermine les foyers de pouvoir mis en jeu par le problème. D’où l’idée de Foucault, qu’il a dès le début, mais qu’il n’expliquera que plus tard, à savoir : le pouvoir est strictement immanent au savoir.
Ça donne quoi concrètement ? On l’a vu. Il veut constituer, par exemple, un corpus de sexualité, c’est-à-dire un corpus des mots, phrases et propositions de sexualité à une époque considérée. Comment [8 :00] constituer le corpus ? La réponse est très simple : déterminons les foyers de pouvoir mis en jeu par la sexualité à tel moment, par exemple, au XIXème siècle. Les foyers de pouvoir, et de résistance au pouvoir, mis en jeu par la sexualité à tel moment, c’est quoi au XIXème siècle ? Eh bien, il nous dira : le pouvoir ecclésiastique, non pas en général, mais particulièrement dans la confession, le pouvoir de l’école, pas en général, mais particulièrement dans le règlement d’internat, [9 :00] le pouvoir juridique, au niveau de l’expertise, pas en général, mais dans l’expertise psychiatrique des perversions, etc. Je peux, en tout cas, assigner un nombre fini de foyers de pouvoir autour desquels, autour de chacun de ces foyers, se forment des cercles de mots, de phrases, de propositions. Je constitue ainsi un corpus. Bien.
Mais vous voyez que ça, ça ouvre pour nous, alors qu’on a à peine entamé la question « qu’est-ce que le savoir ? », [10 :00] ça ouvre pour nous des questions futures, qui sont quoi avant tout ? Je peux déjà les marquer, puis les abandonner tout de suite, parce qu’il faudrait que j’aie déjà fini avec « qu’est-ce que le savoir ? » pour passer à ces questions. C’est : qu’est-ce que c’est que ces centres de pouvoir ? Et surtout, pourquoi est-ce que Foucault brise avec la phénoménologie, dès le début, en nous disant tout le temps « il n’y a pas d’expérience sauvage, il n’y a pas d’expérience libre » ? C’est que l’expérience, elle est toujours conditionnée et quadrillée par des rapports de pouvoir. Et, finalement, l’expérience sauvage, ce serait l’expérience que nous avons des centres de pouvoir quand ils nous interpellent, [11 :00] c’est-à-dire le contraire d’une expérience sauvage, d’une expérience libre. ” Et aussi : d’où le doute de Foucault, la mélancolie de Foucault, lorsqu’il dit : et bien oui, on me dira” – il adorait se faire à soi-même des objections, il vaut toujours mieux se faire à soi-même des objections, parce que celles des autres, c’est… – alors il disait : mais on me dira – c’est-à-dire « je m’objecte » – « mais ça ne va pas ton truc, tu ne franchis pas la ligne », dit-il. « Tu restes toujours du côté du pouvoir ».
Pourtant Dieu, pourtant Dieu, qu’il ne restait pas du côté du pouvoir ! Mais est-ce que, dans sa pensée, il ne reste pas du côté du pouvoir ? Au sens où les rapports de pouvoir, les foyers de pouvoir sont là pour déterminer [12 :00] les corpus. Et dans un texte très beau, emprunté là, comme toujours, à cet article « La Vie des hommes infâmes » [1977], dont je vous parlais un peu la dernière fois, il dit : « on me dira » [Rire de Deleuze], « on me dira : vous voilà bien avec toujours la même incapacité à franchir la ligne, à passer de l’autre côté, à écouter et à faire entendre le langage qui vient d’ailleurs ou d’en bas ; vous faites toujours le même choix, du côté du pouvoir, de ce qu’il dit ou de ce qu’il fait dire ». Et je crois que l’une des raisons du long silence de Foucault, il y a de multiples raisons, entre La volonté de savoir et L’usage des plaisirs, une des raisons au moins, c’est ce problème qui devenait de plus en plus urgent [13 :00] pour lui, à savoir : comment passer de l’autre côté ? Comment franchir la ligne ? Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose encore au-delà des lignes de pouvoir et comment y arriver ?
Mais, pour le moment — on verra comment ce problème est posé et résolu par Foucault — mais, pour le moment, nous, nous pouvons être pleinement contents de cette première réponse. On ne pose pas encore la question du pouvoir, puisqu’on en est en plein dans la question du savoir et on dit juste : eh bien, oui, d’accord, son corpus de mots, de phrases et de propositions, effectivement, il tient bien les conditions de son pari, il peut le former sans rien préjuger de ce qui est en question, à savoir « qu’est-ce que le savoir ? », puisqu’il forme le corpus des mots, phrases et propositions en fonction des foyers de pouvoir et résistance mis en jeu, concernés par le problème correspondant. Vous posez un problème, [14 :00] par exemple : qu’est-ce qui se passe pour la sexualité au XIXème siècle ? Vous formez votre corpus, sans cercle vicieux, dans la mesure où vous vous demandez quels sont les mots, les phrases et les propositions qui tournent autour des foyers de pouvoir concernés par la sexualité ou concernant la sexualité. C’est clair, ça, hein ? C’est très important pour l’avenir, pour nous, puisque ça marque déjà un certain rapport, une certaine présupposition du pouvoir par le savoir.
Alors, une fois que vous avez votre corpus, qu’est-ce que vous faites, [corpus] qui est très divers ? Et vous voyez qu’il tient son unité de ceci : c’est le corpus de sexualité. Qu’est-ce qui se passe ? [Deleuze considère le tableau] Eh bien, [15 :00] de ce corpus, vous induisez quoi ? On l’a vu les dernières fois, quelque chose que l’on peut appeler de noms divers : un « il y a », le « il y a du langage », ou bien — ce qui revient au même — un « on parle », ou bien – ce qui revient au même – un être-langage, un être du langage. Mais voyez, qu’est-ce que c’est, ça ? Ça c’est une généralité vide, « on parle », « il y a du langage », [16 :00] un être-langage ; en quoi c’est lié au corpus ? Comment est-ce qu’on le conclut du corpus ? Ce n’est compliqué, vous vous rappelez, ça c’est le résultat des fois dernières. Il ne s’agit pas d’un universel, c’est que l’être-langage, le « on parle », est inséparable de tel ou tel mode historique qu’il prend par rapport à telle ou telle formation. Il est inséparable de sa modalité historique.
En d’autres termes, c’est ce « on parle », ce « il y a du langage », cet être-langage, c’est une manière dont le langage se rassemble sur telle ou telle formation. Et en effet… [17 :00] Alors, « sur telle ou telle formation », c’est-à-dire la manière dont le langage se rassemble… est-ce que je peux dire au XIXème siècle ? Oui, à la limite, je peux dire : le langage se rassemble d’une certaine façon au XIXème siècle. Mais c’est un grand rassemblement, très grand rassemblement : l’être-langage au XIXème siècle ou le « on parle » au XIXème siècle. C’est vraiment un rassemblement très vaste. Comprenez qu’en fait, il y a un rassemblement du langage pour chaque corpus. Chaque corpus opère un certain rassemblement de tout le langage. Et, en effet, le corpus de sexualité opère un certain rassemblement [18 :00] de tout le langage autour de la sexualité. Si bien que chaque corpus opère un rassemblement et chaque corpus renvoie à un être-langage, à un « il y a du langage ». Simplement je peux parler d’un « il y a du langage » propre à toute une formation historique, dans la mesure où la formation historique se définira par l’ensemble des corpus, par l’ensemble de ces corpus. Alors là, il y aura un grand rassemblement du langage qui correspondra au langage de l’époque ou de la formation. Bien. Ça va toujours ? Vous m’interrompez, hein, s’il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu’il faut que ça, que ça… [Deleuze ne termine pas la phrase]
Alors, bien, je dirais… les énoncés… voilà [Pause ; Deleuze dessine les points au tableau en indiquant le schéma], [19 :00] les énoncés, ils sont comme au croisement (c’est cette ligne en pointillés), ils sont comme au croisement du corpus de mots, phrases et propositions et du rassemblement-langage sur le corpus. Ou bien, dans le livre sur Raymond Roussel, Foucault nous dira : “pour trouver les énoncés, il faut fendre ou ouvrir, il faut fendre, ouvrir, les mots, les phrases et les propositions”. Or qu’est-ce qui ouvre mots, les phrases et les propositions ? C’est le « il y a du langage ». C’est le « il y a du langage », le rassemblement du langage sur le corpus, qui force le corpus à s’ouvrir et à lâcher les énoncés [20 :00] que, sinon, il tiendrait enfermés. Bon.
Mais tout ça c’est des métaphores, hein ? « Fendre, ouvrir », alors bien, j’en suis à ma ligne en pointillés, voilà, je tiens bien le schéma pour l’énoncé, mais il faut que je remplisse l’entre-deux. [Deleuze indique le schéma au tableau] Entre le rassemblement du langage et le corpus sur lequel il se rassemble, c’est là que surgit l’énoncé. Ça ne nous dit pas ce qu’est un énoncé encore, mais ça nous forcera à le dire. Voilà. Repos : j’ai besoin d’un détour… [Interruption de l’enregistrement] [20 :55]
Partie 2
… pôle du savoir aussi [21 :00] essentiel que les énoncés, je n’ai pas le choix, il faut que je trouve un résultat analogue ou un ensemble analogue au niveau du visible. Or il est certain que Foucault fait directement l’analyse pour l’énoncé et la fait beaucoup moins pour la visibilité. Mais ce ne serait pas la première fois que les chemins sont si compliqués que, là où il semble ne pas procéder aux analyses absolument nécessaires, ce soit plutôt là que un peu de clarté vienne pour nous. Car, car, car… qu’est-ce qui se passe pour les visibilités ? Je dirais : mais [22 :00] vous savez, c’est la même chose. C’est la même chose. Vous voulez savoir ce qui est visible à une époque. On a vu ce thème. A une époque, il y a des choses qui peuvent être vues et, quand elles peuvent être vues, elles sont vues, il y en a d’autres qui ne peuvent pas.
Si le XVIIème siècle met dans le même lieu, encore une fois, les fous, les vagabonds, les chômeurs, ce n’est pas parce qu’il ne voit pas la différence, c’est parce qu’il voit une ressemblance qui cessera d’être perceptible à d’autres époques. Quelle ressemblance ? Ce sera ça la visibilité. [Pause] Bon, eh ben, si vous [23 :00] voulez savoir qu’est-ce qu’une visibilité, il faut aussi partir d’un corpus. Ce ne sera pas le même. Cette fois-ci ce ne sera plus un corpus de mots, de phrases et de propositions, ce sera quoi ? Ce sera un corpus d’objets, de choses, d’états de choses, et de qualités sensibles. Vous comprenez peut-être tout de suite que ce qui est en jeu, c’est que, exactement de la même façon que les énoncés…. de la même façon que les énoncés nous le savions, nous ne savions pas, qu’est-ce qu’ils étaient ? Mais, nous savions une chose : si ça a un sens, [24 :00] les énoncés, ça ne se laisse réduire ni aux mots, ni aux phrases ni aux propositions, ce n’est pas la même chose. Les visibilités, nous ne savons pas ce que c’est, mais nous savons que, si ça existe, ça ne se laisse réduire ni aux choses, ni aux objets, ni aux états de choses, ni aux qualités sensibles.
Si bien que, je pars d’un corpus d’objets, de choses etc., et, par-là, je ne présuppose rien de ce qui est à trouver, à savoir : « qu’est-ce qu’une visibilité ? ». Je pars d’un corpus, corpus de choses, états de chose, qualités sensibles à une époque. [Pause] Ça peut être un corpus [25 :00] architectural entre autres. Il y aura toujours des architectures dans mon corpus. Ou bien, si je m’intéresse à la peinture, je pars d’un corpus constitué par tel, tel, tel tableaux. Je ne vais pas parler — de même que c’est faux que le linguiste parle du langage en général, il part toujours d’un corpus déterminé – ben, un critique d’art ne part pas de la peinture du XVIIème siècle en général. Il part d’un corpus déterminé, c’est-à-dire un ensemble déterminé de tableaux et, sans doute, les résultats ne seraient pas les mêmes si on prend un autre corpus.
En tout cas, même problème que tout à l’heure : oui, mais, ce corpus, comment je le constitue ? [26 :00] La réponse de Foucault, à mon avis — réponse implicite, mais justement on peut la… — la réponse implicite sera la même que pour le corpus de phrases, à savoir : “je me réclame des foyers de pouvoir et de résistance mis en jeu par le problème que je considère”. Qu’est-ce que ça veut dire au niveau de la peinture du XVIIème siècle ? Il faut que ça veuille dire quelque chose, si j’ai raison, dans cette lecture de Foucault ; il faut que ça veuille dire quelque chose. Eh bien oui, par exemple, je vois que, au XVIIème siècle — là je dis des énormités, des évidences — je vois qu’au XVIIème siècle, au moins tout un corpus de peintures [27 :00] peut être déterminé comme « le portrait », le portrait. Je peux me dire : bon, dans la seconde moitié du XIXème siècle se fera un retour au portrait, notamment avec [Vincent] Van Gogh et [Paul] Gauguin. Il ne faut pas s’y connaître beaucoup en peinture pour savoir que le portrait, pour Van Gogh et Gauguin, ne fait pas partie de même corpus que le portrait chez les peintres du XVIIème siècle, donc que le portrait en général, la peinture de portrait, ne formerait pas un corpus, c’est à cheval sur plusieurs corpus. [28 :00]
Qu’est-ce qui est en jeu dans le corpus « portrait au XVIIème siècle » ? Entre autres — je ne dis pas « seulement » — immédiatement des rapports de pouvoir. Quels rapports de pouvoir ? Rapports de pouvoir entre le peintre et son modèle. C’est un rapport de pouvoir, le peintre et son modèle. Au XVIIème siècle, qu’est-ce que c’est le modèle ? C’est, avant tout, le seigneur, ou, mieux encore, le roi. Qu’est-ce que “Les Ménines” de [Diego] Vélasquez, dans le commentaire célèbre [29 :00] qu’en tirera Foucault, il s’agit de quoi ? Il s’agit d’un tableau qui nous montre comme de face la famille royale et le peintre qui regardent quelque chose, ou quelqu’un, qu’on ne voit pas. Le regard du peintre et ce que tous regardent, on ne le voit dans le tableau que sous la forme d’un reflet dans le miroir, au fond. Et ce que tous regardaient, c’était la personne royale, qui, on le voit dans le miroir, regarde ceux qui le regardent. En d’autres termes : échange de regards, soit, mais autour d’un rapport de pouvoirs : le pouvoir du peintre et le pouvoir du roi. [30 :00] Bon. Donc il me semble qu’à ce niveau les analyses mêmes de Foucault confirment : le corpus que je vais constituer est bien déterminé en fonction des foyers de pouvoir qui sont mis en jeu par le problème posé, par exemple « qu’est-ce qu’un portrait au XVIIème siècle ? ». Bien. J’ai donc mon corpus que je peux dire architectural, pictural tout ce que vous voulez. Bien.
Donc, jusque-là, le parallélisme entre mes deux séries, l’énoncé et la visibilité, se vérifie. Qu’est-ce que je fais, une fois que j’ai mon corpus ? Une fois que j’ai mon corpus… Mon corpus peut n’être qu’un seul tableau. Ça peut être dix tableaux. [31 :00] Ça peut être l’ensemble tableau-architecture, vous voyez : ça peut être, à la limite, le corpus du siècle, ou de la formation historique. Eh bien, une fois que j’ai mon corpus, je dresse…, je fais la même chose, je dresse ma verticale et je pose la question : qu’est-ce qui se rassemble dans le corpus, sur le corpus ? Ce n’était pas difficile tout à l’heure : ce qui se rassemblait sur le corpus des mots, phrases et propositions, c’était l’être-langage sur ou sous, tel ou tel mode. Là qu’est-ce qui se rassemble sur le corpus, sur le corpus physique des choses, états de choses, [32 :00] qualités etc. ? Bien. Il m’a semblé que la réponse de Foucault était — je dirais aussi bien — « il y a de la lumière », ou bien — mais ça ne va pas être facile à comprendre, ou si, peut-être, je ne sais pas — ou bien « on voit », ou bien « l’être lumière », le rassemblement de toute la lumière sur le corpus. Bon. [Pause] Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu’un tableau, finalement, c’est une figure de lumière. Ce qui [33 :00] est premier, c’est la lumière. Non, là il ne s’agit pas de savoir si c’est vrai, pas vrai etc., il s’agit de savoir jusqu’à quel point cette idée est importante et intéressante. Une mauvaise idée, c’est une idée qui n’a pas d’intérêt ; une idée bonne, c’est une idée importante, intéressante.
Alors, bon. Je comprends ce que ça veut dire : mais oui, un tableau rassemble, sur un mode particulier, sur son mode, toute la lumière du monde — il ne la divise pas, la lumière, elle est indivisible — il rassemble, sur tel ou tel mode, toute la lumière du monde. Exactement comme un corpus de mots, de phrases et de propositions rassemble sur son mode particulier, tout le langage du monde. [34 :00]
Ce qui est premier, c’est la lumière : ça veut dire quoi ? Ça veut dire : la lumière, ne croyez pas que ce soit un milieu physique. La lumière n’est pas plus un milieu physique, c’est-à-dire la lumière n’est pas newtonienne. La lumière n’est pas plus un milieu physique que — elle est aussi un milieu physique, mais, par exemple, on appellera « lumière seconde » la lumière comme milieu physique — la lumière, elle est quelque chose de plus. Qu’est-ce qu’elle est ? Eh bien, elle est ce que Goethe voulait, et non pas [Isaac] Newton, à savoir : c’est un indivisible, c’est une condition, c’est une condition de l’expérience et du milieu. [Pause] [35 :00] C’est une condition indivisible. C’est ce que les philosophes appellent un a priori. Les milieux se développent ou s’étalent dans la lumière. La lumière n’est pas un milieu. La lumière est une condition a priori, c’est-à-dire — c’est signé Goethe, contre Newton — ce que l’on peut diviser, c’est une lumière seconde. La lumière première est un indivisible. Elle tombe sur le corpus de choses, d’états de choses, et de qualités ; exactement comme le tout du langage, l’être-langage, tombait sur le corpus de mots, de phrases et de propositions. La lumière ne se divise pas : elle tombe. [36 :00] Et, en tombant, elle capture ce sur quoi elle tombe. Ce qui est premier, en peinture, c’est la lumière, premier par rapport aux lignes, premier par rapport aux couleurs. Les couleurs et les traits découlent de la lumière et pas l’inverse. Un tableau c’est d’abord un tracé de lumière.
Vous me direz : mais pourquoi il dit ça ? Ben, il dit ça, voilà ! A vous de savoir si ça vous convient ou pas. Si ça ne vous convient pas : aucune importance. Sentez que c’est idiot de se dire : mais enfin, c’est vrai ou ce n’est pas vrai ? Ça n’a pas de sens puisqu’il propose une analyse telle qu’il dégage une condition par rapport à quelque chose de conditionné. Lui, il a l’impression que, devant un tableau, par exemple, supposons, il a l’impression que la lumière joue le rôle de condition par rapport aux lignes et aux couleurs. Est-ce qu’on peut faire une [37 :00] théorie aussi intéressante où ce serait la couleur qui serait lumière ? Question stupide : il faut le faire. Il faut le faire, on verra bien. Hein ? Est-ce que c’est question de goût ? Non, ce n’est pas question de goût. Ce n’est pas par hasard que certains d’entre nous serons poussés à dire : non, ce n’est pas la lumière qui est première.
Alors tout se vaut ? Non, pas du tout, tout ne se vaut pas, il faut le faire. Voilà : au point où nous en sommes, nous, qu’est-ce qui nous intéresse ? On voit bien que, en quel sens, pour Foucault, un tableau c’est avant tout un tracé de lumière. Ce n’est pas des lignes solides, le trait, en peinture, c’est une ligne solide. [Pause] [38 :00] Au-delà des lignes solides, ou plutôt comme condition de toutes les lignes solides, il y a des lignes de lumière. Et des lignes de lumière, ce n’est pas des lignes solides peintes en jaune. Or, par exemple, dans le tableau de Vélasquez, Foucault nous fait une description p. 27 [dans Les Mots et les choses], une description, à un moment, en termes de lumière. [Pause] « L’échancrure par où se déverse la lumière… ». Alors la figure de lumière, voilà ce qu’il nous dit : « Cette coquille en hélice offre [39 :00] tout le cycle de la représentation : le regard » — le regard du peintre sur la toile – « la palette et le pinceau, la toile dont on ne voit que l’envers, les tableaux, les reflets » — etc. etc. — « On n’en voit plus que les cadres, et cette lumière qui baigne de l’extérieur les tableaux, mais que ceux-ci en retour doivent reconstituer en leur espèce propre, tout comme si elle venait d’ailleurs, traversant leurs cadres de bois sombre. Et cette lumière, on la voit, en effet, sur le tableau qui semble sourdre dans l’interstice du cadre ; et de là elle rejoint le front, les pommettes, les yeux, le regard du peintre qui tient d’une main la palette, de l’autre le fin pinceau. Ainsi se ferme la volute, ou plutôt, par cette lumière, elle s’ouvre » [Les Mots et les choses, p. 27]
On voit bien, on voit les lignes de lumière, ce ne sont pas des lignes solides tracées par le peintre. [40 :00] C’est vraiment la condition qui déploie le tableau comme champ, comme champ de quoi ? Champ de visibilité. En d’autres termes, de même que le “il y a du langage” était un a priori, mais un a priori historique, puisque c’était la condition relative à tel corpus ou à telle formation historique, le “il y a de la lumière” est un a priori historique. La lumière au XVIIème siècle, c’est-à-dire, la manière dont la lumière se rassemble, soit dans la peinture du XVIIème siècle, soit dans les portraits du XVIIème siècle, soit encore dans un seul cas, la manière dont toute la lumière du monde se rassemble dans “Les Ménines” de Vélasquez. Si bien que les visibilités, ce sera exactement comme ce que je viens de dire pour les énoncés. [41 :00] Ce sera la ligne pointillée qui s’ouvre ; pour trouver les visibilités il faut fendre les choses, il faut ouvrir les qualités. Les visibilités ne sont ni des choses, ni des qualités. Alors qu’est-ce que c’est ? C’est ce qui surgit à la rencontre du corpus de choses et de qualités, et de l’être-lumière. [Pause] Ce sont les lignes de lumière, les visibilités.
Bon. Mais alors, en d’autres termes, les visibilités ne se définissent pas d’abord comme des actes d’un sujet voyant, ni comme [42 :00] les données d’un organe visuel. Surtout pas : ce ne sont ni des qualités, ni des états de chose, ni des visions. Le “on voit” n’est pas une vision, le “on voit” c’est la lumière. Le “on”, c’est la lumière, exactement comme le “on parle”, le “on”, c’est le langage.
Mais alors pourquoi appeler ça des visibilités ? Parce que « lumière », parce qu’elles sont données par la lumière. Par la lumière comme indivisible. Et, en tant que données par la lumière, alors, oui, elles se rapportent à la vue, mais elles ne se rapportent à la vue que parce que données à la lumière, [43 :00] par la lumière. Bien plus : c’est par la lumière qu’elles se rapportent à la vue. En d’autres termes, comprenez, elles ne se rapportent à la vue que secondairement. Les visibilités ne se rapportent à la vue que secondairement, elles sont en effet rapportées à la vue par la lumière. Dès lors, on ne s’arrête pas, on ne peut plus s’arrêter. C’est un emballement car, si les visibilités ne se rapportent à la vue que secondairement, elles ne se rapportent pas à la vue, ou plutôt elles ne sont pas rapportées à la vue, sans être rapportées aussi aux autres sens. A l’oreille, au tact, etc. Si bien que les visibilités, loin d’être des données de l’organe visuel, [Pause] [44 :00] c’est quoi ? C’est des complexes multi-sensoriels, optiques, auditifs, tactiles… Mais pourquoi appeler ça des « visibilités » ? En fait ce sont des complexes d’actions et de réactions, des complexes multi-sensoriels d’actions et de réactions, d’actions et de passions. Pourquoi les appeler « visibilités » ? Ce sont des visibilités en tant que ces complexes n’existent que dans la mesure où ils viennent à la lumière. Ils n’existent pas tant que la lumière ne les tire pas à elle, tant que la lumière ne les fait pas venir. [Pause]
Ah bon ? Mais enfin, est-ce qu’il dit ça, [45 :00] Foucault ? Très bien, mais est-ce qu’il le dit ? Vous comprenez ? Les visibilités sont dites des visibilités parce qu’elles trouvent leur condition dans la lumière, comme indivisible, comme élément indivisible — pas du tout Newton, Goethe — dès lors les visibilités ne sont rapportées à la vue que secondairement et, dans la mesure où la lumière les rapporte à la vue, la lumière ne les rapporte pas à la vue sans les rapporter aussi aux autres sens. Est-ce qu’il dit ça ? Oui, il le dit. Oui, oui, oui, oui. Il le dit et dans un passage très curieux de Naissance de la clinique, où, là, l’exemple qu’il prend n’est plus esthétique, artistique, [46 :00] mais épistémologique. Il s’agit de ce qui se passe en anatomie pathologique, et il nous dit que, je lis le passage… C’est à propos des nouvelles méthodes introduites par [René] Laennec, et vous savez que Laennec est célèbre, entre autres, pour avoir introduit dans la médecine, dans le diagnostic, des données tactiles et sonores. Une percussion des maladies et une audition des maladies. Et voilà comment Foucault commente [47 :00] : « lorsque Corvisart » — c’est un autre médecin de la même époque – « entend un cœur qui fonctionne mal » — c’est donc auditif – « lorsque Laennec entend une voix aiguë qui tremble, c’est une hypertrophie et c’est un épanchement qu’ils voient » ; « Lorsque Corvisart entend un cœur qui fonctionne mal, Laennec entend une voix aiguë qui tremble, c’est une hypertrophie, c’est un épanchement qu’ils voient. De ce regard qui hante secrètement leur audition et au-delà d’elle l’anime… » [Naissance de la clinique, (Paris : PUF, 1963) p. 167]
« Ce regard qui hante secrètement leur audition… », c’est-à-dire : ce regard, ce “on voit”, [48 :00] ce n’est pas un regard en fait, c’est l’être-lumière qui tire à la lumière non seulement le vu, mais également l’entendu et le touché. Ce n’est pas une question d’espace, cette question de « venir à la lumière ». Lorsque Corvisart entend un cœur qui fonctionne mal, il y a quelque chose qui vient à la lumière, quoi ? Hypertrophie. « De ce regard qui hante secrètement leur audition et au-delà d’elle, l’anime… », et Foucault continue : « Ainsi le regard médical, depuis la découverte de l’anatomie pathologique, se trouve dédoublé : il y a un regard local et circonscrit » — ça c’est le “je vois”, moi je vois avec mon œil — « il y a un regard local et circonscrit, [49 :00] le regard limitrophe du toucher et de l’audition ». Le regard du “je vois”, en effet, c’est ce que voit mon œil, qui est voisin de ce que je sens, de ce que j’entends, « c’est un regard limitrophe du toucher et de l’audition et qui ne recouvre que l’un des champs sensoriels », qui ne recouvre que l’un des champs sensoriels, un parmi les autres : il y a le champ optique, mais il y a le champ auditif, il y a le champ tactile etc. Un parmi les autres.
Foucault nous dit bien : ça ce n’est que le premier regard, ou plutôt, il faudrait dire, ce n’est que le regard second, car ce regard second est conditionné — mais de même que les autres champs sensoriels — par un regard premier. Le [50 :00] regard premier ne conditionne pas le regard second sans conditionner aussi les autres champs sensoriels, c’est-à-dire : il conditionne le regard second dans ses rapports avec les autres champs. Et en effet, Foucault nous dit : « mais il y a un regard absolu » — en fait, ce n’est pas un regard, c’est l’être lumière — « il y a un regard absolu, absolument intégrant, qui domine et fonde toutes les expériences perceptives. C’est lui qui structure en une unité souveraine ce qui relève à un plus bas niveau de l’œil, de l’oreille et du tact ». Le mot « regard absolu » n’est évidemment pas heureux ; si, il est très heureux d’ailleurs, il faut y substituer l’être-lumière. C’est la même chose ; le regard absolu, c’est la lumière. [51 :00]
Pour ceux qui étaient là les autres années, vous vous rappelez peut-être que, chez [Henri] Bergson, il y a un thème très semblable : la lumière est dans les choses, le regard est dans les choses. « Il y a un regard absolu » — c’est-à-dire un être-lumière – « qui domine et fonde toutes les expériences perceptives ». C’est très proche aussi de [Martin] Heidegger, vous savez, c’est la Lichtung et, dans le cas de Heidegger, la filiation avec Goethe est immédiate, mais je crois non moins à une filiation, à une filiation dans le cas de Foucault, une filiation directe avec Goethe sur le thème de la lumière comme condition indivisible.
Et il continue : « Quand le médecin observe, quand le médecin observe [52 :00] tous ses sens étant ouverts, un autre œil »… quand le médecin observe avec ses yeux, mais aussi, quand il percute avec ses doigts, quand il écoute avec ses oreilles… « Quand un médecin observe, tous ses sens ouverts, un autre œil est posé sur la fondamentale visibilité des choses ». « La fondamentale visibilité des choses », ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand les choses ne sont plus là comme choses, quand les choses sont fendues et ouvertes et libèrent les visibilités pures. Et les visibilités pures, c’est quoi ? C’est le rapport des choses, des états de chose, des qualités avec la lumière première comme condition indivisible. Alors les visibilités surgissent. Quand la lumière première tombe sur les choses, alors les choses se fendent, [53 :00] elles s’écaillent, elles s’ouvrent. Elles s’ouvrent pour faire surgir quoi ? La pure visibilité qui monte à la lumière. Et cette pure visibilité, sans doute, elle sera rapportée à l’œil, mais elle ne sera pas rapportée à l’œil sans être rapportée aussi aux autres sens. Donc ça va très bien. Ça va très bien !
Ça veut dire quoi ça ? Prenez un autre, cette fois-ci un autre penseur qui se trouve être un peintre lui-même. J’en ai parlé d’autres années : [Robert] Delaunay. En quoi Delaunay est proche de Goethe lui aussi ? C’est très simple. Delaunay, ce n’est pas qu’il nous dise : qu’est-ce qui nous fait voir ? [54 :00] Il a une idée, une idée de peintre. L’idée de peintre de Delaunay, elle est très simple, c’est difficile à faire en peinture, mais elle est très simple à dire, à savoir : les figures ne sont pas d’abord solides, ce qui est premier, c’est les figures de lumière. C’est-à-dire : la visibilité, c’est la figure rapportée à la lumière. A ce moment-là, ce n’est plus une figure solide. La lumière, elle aussi, c’est une condition indivisible et, cette condition indivisible, c’est quoi ? Production des figures lumineuses. La lumière produit des figures qui lui appartiennent.
Vous voyez : la lumière n’est plus composée, comme chez Newton, c’est ça la grande division entre les newtoniens et les goethéens. La [55 :00] lumière, c’est une condition indivisible et, dès lors, productrice, elle produit des figures qui n’appartiennent qu’à elle. En d’autres termes, la lumière est mouvement, la lumière est production. Dès lors, il ne faut pas confondre les choses qui se meuvent et les mouvements de la lumière. Et il ne faut pas confondre non plus les lignes de choses et les lignes de lumière. Et il ne faut pas confondre non plus la figure de la chose lorsque la lumière la rencontre et les figures mêmes de lumière que la lumière forme [56 :00] à la surface des choses. Et la tâche du peintre pour Delaunay, c’est quoi ? Fendre les choses, ouvrir les états de choses pour révéler les pures figures de lumière. Et qu’est-ce que ça va être cette révélation ? Ça va être les figures célèbres chez Delaunay, les cercle, les demi-cercles, les hélices, avec la grande division : il y a des figures lunaires et des figures solaires. La Lune n’est pas moins lumière que le soleil, si bien que, à la limite, c’est une condition fourchue, la lumière est condition indivisible : oui, mais elle a au moins deux faces, solaire et lunaire. Bon, et les hélices lumineuses de Delaunay, les cercles, les demi-cercles [57 :00] lumineux de Delaunay vont affirmer leur primat, et sur les lignes solides, et sur les couleurs. Les couleurs “sortent” de la lumière, les lignes “sortent” de la lumière. Ce qui est premier, c’est la visibilité, c’est-à-dire la figure de lumière.
Et Delaunay avait un mot admirable, qui fait tout comprendre de son entreprise, c’était un mot d’esprit, mais c’est parfois les mots d’esprit… Il réglait ses comptes avec le cubisme, avec les cubistes, et il disait : vous comprenez, qu’est-ce que c’est l’apport de Cézanne en peinture ? Il était génial, Delaunay, il avait bien vu, il disait l’apport fondamental de [Paul] Cézanne en peinture, c’est d’avoir cassé le compotier. C’est bien parce que casser le compotier, c’est fendre les choses.
Cézanne, au XIXème siècle, il a fendu les choses. Sans doute les impressionnistes avaient préparé, mais, non, ils n’avaient pas fendu les choses dans leur [58 :00] matérialité, ils avaient fait jouer les reflets, c’était un régime de lumière très particulier : ils avaient fait jouer les reflets sur les choses. Mais Cézanne, lui, il casse le compotier, c’est-à-dire il fend, il brise la chose dans sa matérialité. Et il dit : ce n’est pas la peine d’essayer de le recoller. Les cubistes, c’est comme des types – c’est bien fait pour eux, mais d’une certaine manière, c’est juste — il dit : c’est des types qui essaient perpétuellement de recoller le compotier mais qui se trompent, ils mettent un morceau qui ne va pas avec un autre morceau qui ne va pas et ils pensent avoir recollé. Et en effet, ils ont recollé. Mais il ne fallait pas recoller ce que Cézanne avait cassé. Il fallait au contraire aller dans la direction de Cézanne, c’est-à-dire faire surgir les nouvelles figures que Cézanne avait rendues possibles, [59 :00] c’est-à-dire les pures visibilités. Voilà.
Alors je dis, bon, comprenez que je ne cherche pas à pousser Foucault sur des points qu’il n’a pas développés, je dis juste : on en reste là au niveau des visibilités. C’est pour ça que, moi, je répondrais à ta question : non, les visibilités, ce n’est pas du tout… il n’y a pas de… c’est exactement comme les énoncés. De même que les énoncés impliquent le langage, mais toutes les choses impliquent des visibilités : il suffit de les casser. Or il faut les casser. Le corpus n’est là que pour que des visibilités surgissent et, les visibilités, ce ne sont pas des données de la vue. Elles sont rapportées à la vue, bien plus, j’ai oublié, dans le texte des… [60 :00] que je vous lisais, [page] 167, il emploie un mot très étrange : « de toutes façons la limite absolue, le fond de toute exploration perceptive sont dessinés toujours par le plan clair d’une visibilité au moins virtuelle ». Vous voyez, pourquoi « visibilité virtuelle » ? C’est que la visibilité ne se rapportera réellement, actuellement à la vue que par l’intermédiaire de la lumière et qui ne la rapporte pas à la vue sans la rapporter aux autres sens.
Bon, alors vous voyez. Vous voyez quoi ? Vous voyez… Je vais vous dire : en quoi ça peut être une méthode ? C’est une méthode, elle m’apparaît très riche, hein, parce que [61 :00] la méthode des visibilités, là, elle peut fonder tout un domaine d’analyses esthétiques. Puisqu’on a vu : pour les architectures, c’est pareil. Il faut fendre, pour comprendre une architecture, il faut voir, il faut la comprendre comme : l’architecture est un régime de distribution de la lumière. Il y a des régimes de lumière exactement, il y a des régimes de visibilité, tout comme il y a des régimes d’énoncés. Avant d’y voir… encore une fois je vous le disais, une prison, c’est quoi ? C’est un régime de visibilité. Un asile, un hôpital c’est quoi ? C’est un régime de visibilité. Pensez, c’est même terrifiant et c’est par-là que, c’est par-là que c’est tellement lié au pouvoir, et que Foucault en était très, très conscient que… le pouvoir, c’est [62 :00] perpétuellement ce par quoi on est vu et parlé. Le pouvoir nous parle et le pouvoir nous voit.
Quand est-ce que vous savez que vous êtes à l’hôpital ? Vous savez que vous êtes à l’hôpital lorsque, au lieu de la porte pleine de votre chambre, vous voyez cette porte inquiétante où vous êtes vus. Vous savez les trois petites barres là, et puis vous êtes sûrs que la porte ne ferme pas, c’est-à-dire que la surveillante générale, comme on dit dans les hôpitaux comme dans les écoles, que la surveillante générale peut entrer à chaque instant. Terrible, terrible ! Je ne parle pas des prisons : on l’a [63 :00] vu, elles sont faites pour ça, c’est-à-dire toute leur architecture de pierre est faite pour qu’elles fonctionnent, que les prisonniers soient vus sans voir eux-mêmes, et que ceux qui les voient ne soient pas vus.
Vous me direz : si vous vous donnez une équation de ce type, je dirais : ça c’est une équation de visibilité. Comment résoudre l’équation ? Avec des pierres, c’est-à-dire avec des choses et des états de choses. Mais ce que vous aurez incarné avec des pierres c’est votre équation, c’est-à-dire c’est la visibilité pure. Je dis : les prisonniers doivent être vus sans voir, les gardiens doivent voir sans être vus. Ça, oui, c’est ce que j’appellerais une visibilité virtuelle, une distribution de voir et d’être vu. Qu’est-ce qui l’actualise, [64 :00] qu’est-ce qui la réalise cette visibilité virtuelle ? Réponse toute simple : ce sont des pierres, c’est une disposition de pierres. Une disposition de matériaux… Une disposition de matériaux qui sont des matériaux que vous pouvez toucher, sentir, écouter, entendre, entendre le bruit qu’ils font, etc. Tout ça, qu’est-ce que c’est ? C’est uniquement l’actualisation de la figure de lumière. Vous comprenez, Foucault, ça va beaucoup plus loin que dire : il y a un sens qui a le primat ; il ne dit pas du tout : la vue a le primat sur les autres sens. Il nous dit quelque chose de beaucoup plus profond. Il nous dit : la lumière, comme condition de la vue, ne rapporte pas le visible à la vue, sans rapporter aussi, le visible aux autres sens. C’est un primat de la lumière, ce n’est pas un primat d’un sens sur un autre. [Pause] C’est [65 :00] par-là que c’est complètement goethéen.
Bon, je dis donc : vous pouvez en tirer une méthode d’analyse esthétique. Vous pouvez en tirer une méthode d’analyse scientifique, sur les énoncés scientifiques. Mais ce qui complique, c’est que — mais ça on ne pourra le voir que plus tard, puisqu’on a vu que ce sera un problème pour nous, il faudra bien revenir à ce problème — les deux, là, ils n’ont pas la même forme, ils ont beau être complètement parallèles, entre les visibilités et les énoncés il y a une différence de nature absolue. Ça, on ne pourra retrouver ce problème que plus tard. Mais, toutefois, ça n’empêche pas, je tiens à le dire, dès maintenant, parce qu’on pourra se débrouiller là-dedans que plus tard, mais, je vous rappelle quand même que, bien qu’il y ait une différence de nature absolue entre les deux, ça n’empêche pas que chacun des deux ne cesse pas de capturer l’autre. [66 :00] A savoir : les régimes de visibilité capturent des énoncés, les régimes d’énoncé capturent des visibilités… [Interruption de l’enregistrement] [1 :06 :11]
Partie 3
… La littérature n’est pas seulement faite d’énoncés, elle est faite aussi de visibilité capturée par les énoncés. Comment marquer cette différence dans le langage, entre les énoncés et les visibilités capturées ? Je crois fort à la différence de nature, dans le langage, entre les énoncés et les descriptions. Les descriptions ne sont pas des énoncés, ce sont des visibilités. J’ai pour moi de très grands logiciens, par exemple, [Bertrand] Russell qui, dans son livre fondateur de la logique moderne, les Principes des mathématiques [1903], marquait déjà la différence de nature entre les propositions [67 :00] et les descriptions. Et, d’une certaine manière, la littérature moderne a beaucoup développé la différence de nature aussi entre… — d’une toute autre manière que chez Russell — par exemple, le Nouveau Roman est, je crois, tout entier fondé sur une certaine dualité entre les énoncés et les descriptions.
Chez Foucault aussi, il y a chez lui des énoncés, des énoncés philosophiques, mais pourquoi est-ce que, d’un bout à l’autre, son œuvre est comme entrecoupée de descriptions, soit descriptions de tableaux, soit descriptions de choses que Foucault traite comme [68 :00] si c’était des tableaux. Par exemple, quand il décrit la prison, il la décrit comme si c’était un tableau. Il y a une fonction propre de la description chez Foucault qui ne se réduit pas à l’énoncé. Or, il y a un auteur, parmi les grands génies de notre littérature, de la littérature moderne, il y a un auteur, il me semble qui a imposé ça, si vous voulez le plus grand luministe, de même qu’il y a des luministes en peinture, de grands luministes en peinture — par exemple, Delaunay : ce n’est pas un coloriste, ce n’est pas un dessinateur, c’est un luministe — ben il y a de grands luministes en littérature.
Je crois que le plus grand luministe en littérature moderne, c’est [William] Faulkner. Si j’essaie de juste [69 :00] indiquer l’exemple Faulkner dans ce schéma qu’on vient de dégager, qu’est-ce que ça donnerait ? Est-ce que ça peut… Il faut qu’une méthode ait beaucoup d’applications, ait beaucoup de fécondité. De quoi il s’agit chez Faulkner ? D’abord quelque chose d’effarant, d’effarant, à savoir : tous les sens sont convoqués, tous les sens, y compris les sens les plus abjects, ils sont convoqués par quoi ? Par la lumière et les variations de lumière selon les heures et les saisons. Les descriptions de Faulkner… si on me disait : qu’est-ce que c’est que l’objet fondamental de la description ? C’est-à-dire ce qui ne peut être que décrit — n’importe quoi peut être décrit, mais ça peut être aussi autre chose que décrit — mais qu’est-ce qui ne peut être que décrit ? [70 :00] La lumière, les états de la lumière. C’est précisément parce qu’ils ne peuvent être que décrits qu’ils sont tellement difficiles à décrire.
Ceux qui connaissent Faulkner savent bien que, à ma connaissance, il n’y a pas dans l’histoire de la littérature mondiale, un autre auteur comme lui pour savoir décrire, parfois en plusieurs pages, une nuance de lumière qui tombe sur un ensemble de choses. Et les choses sont vues. Mais la visibilité, ce n’est pas les choses qui sont vues. Car les choses qui sont vues, elles sont aussi entendues, flairées etc. Tous les sens sont convoqués chez Faulkner évidemment. Les choses sont vues, flairées, maniées, tripotées etc. Tous les sens s’exercent avec une violence… mais avec d’autant plus de violence que, tous ensemble, [71 :00] ils sont tirés à la lumière. Lumière d’Août, ils sont tirés à la lumière d’août. Ils sont tirés à la lumière de cinq heures du soir. Alors la visibilité surgit, alors les choses s’ouvrent et la visibilité surgit. Il n’y a pas d’auteur de lumière comme Faulkner. Et c’est peut-être lié au sud, au sud des USA, puisque c’est le lieu de Faulkner — je précise pour ceux qui ne connaissent pas Faulkner — c’est peut-être lié à la lumière du sud, la lumière d’août dans un Etat du sud. Ouais, peut-être… Qu’est-ce qui fait qu’il a ce génie de la lumière ? Bon, qu’est-ce qu’il fait Faulkner ? Faulkner, c’est vraiment celui qui fait surgir des choses multisensorielles, [72 :00] non pas le primat d’un sens qui serait la vue, mais la pure visibilité. La visibilité dans son aspect de cruauté, de crudité absolue et c’est cet être-lumière qui se rassemble dans chaque roman de Faulkner, si bien que le corpus faulknérien, ce serait le « il y a de la lumière » telle que elle tombe sur l’ensemble des romans de Faulkner ou sur tel roman, ou sur telle page de roman.
Et, parallèlement, il y a les énoncés faulknériens. Et, ces énoncés faulknériens, chacun sait qu’ils surgissent quand quoi ? Quand Faulkner a, comme second pôle de son génie, cassé les phrases, les propositions, les mots en les rapportant à un tout du langage qui va les brasser. [73 :00] Et les énoncés ce sera quoi ? Les énoncés faulknériens seront saisis au point où un même nom renvoie à deux personnes différentes, ou bien où une même personne a deux noms différents. Et c’est les généalogies là, de ces familles du Sud, de Faulkner…
Et si j’ajoute, pour tout rendre cohérent — mais il n’y a pas besoin — et qu’est-ce qui se joue dans les deux corpus, le corpus de phrases et le corpus physique ? Qu’est-ce qui se joue au niveau des énoncés faulknériens, comme au niveau des visibilités faulknériennes ? La réponse est très simple : ce qui se joue, c’est d’abominables rapports de pouvoir, à savoir : la décadence, la décadence du Sud, [74 :00] la dégénérescence de ces familles anciennement puissantes — tous ceux qui ont lu un peu de Faulkner savent ça — des foyers qui sont à la fois des foyers de pouvoir rongeant et rongés, et tout ça, l’ensemble de ces énoncés rapportés aux foyers de pouvoir qui s’agitent en eux, ça donne quoi ? Ça donne — là je tombe dans ce qui est le plus connu chez Faulkner — ça donne la fameuse histoire, pleine de bruit et de fureur, racontée par un idiot. L’histoire racontée par un idiot, c’est le “on parle”, il faudrait juste ajouter qu’elle n’est pas seulement racontée par un idiot, elle est vue par un débile. Et le « vue par un débile », c’est la visibilité, comme le « racontée par un idiot », c’est l’énonçabilité. L’énoncé n’a [75 :00] jamais comme sujet qu’un idiot, c’est-à-dire une position dans le “on” de “on parle”. La visibilité n’a jamais comme sujet qu’un “on” dans “on voit”, c’est-à-dire une place dans l’être-lumière.
Alors très bien. Bon, bon, bon, bon, alors quoi ? Eh bien, dès lors, on est d’accord, on a tiré tout ce qu’on pouvait du parallélisme. Maintenant il faut revenir là. Admettons qu’on ait une vague idée, maintenant, de ce que c’est qu’une visibilité par distinction d’avec une chose vue. Raison de plus, pour revenir, maintenant on ne peut plus détourner, il s’agit de dire : qu’est-ce que c’est [76 :00] qu’un énoncé ? En quoi un énoncé n’est ni un mot, ni une phrase ni une proposition ? Il faut essayer. Je veux dire : on a une vague idée en effet. Au point où on en est, on a une vague idée. Les énoncés, en effet, ne sont pas des phrases, des propositions… mais en quoi ? En quoi ? En quoi ? Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher tant qu’on n’aura pas de réponse possible. Alors on va chercher. Mais, comment, bon… ça va ? [Rire de Deleuze] Je ne vous demande pas ça par souci de votre santé, je vous demande ça parce que… on va se reposer hein, un petit peu ; mais 10 minutes hein ? Pas plus de 10 minutes ! Quelle heure il est ? [Réponse : 11 heures moins 20]… [Interruption de l’enregistrement] [1 :17 :00]
… Est-ce qu’il y a des questions qui me permettraient de ne pas avancer ? Pas de questions ? Une petite question… Non, pas de questions ?
Un étudiant : [Propos inaudibles]
Deleuze : oui ? Une question !
L’étudiant : Vous avez fait une allusion à la lumière chez Heidegger…
Deleuze : Ah oui, alors ça, ça viendra après hein, un parallèle avec Heidegger parce que… Oui, oui, alors pas maintenant hein ! Une autre question ? [Rires] Pas d’autres questions ?
Bon, eh bien alors, allons-y, il faut bien avancer puisqu’il n’y a pas de question. Eh bien, écoutez, voilà : je crois — c’est [78 :00] du domaine du « je crois », alors vous vous débrouillez — je crois quand même que on peut essayer d’assigner la différence entre les énoncés, d’une part, et, d’autre part, le groupe « mots, phrases, propositions », à quatre niveaux. Quand on aura vu les quatre, on n’en pourra plus, mais on ne les verra pas aujourd’hui hein ! Quatre niveaux. Voilà. Eh bien, voilà c’est fini ! [Rires]
Donc : premier niveau. — Je cherche la moindre occasion de ne pas… enfin… Non ? Pas de questions ? [Rires] — Premier niveau. [Pause] [79 :00] Il n’y a pas que la logique qui s’occupe des propositions. D’une certaine manière — il faut bien les numéroter hein, mes niveaux, parce que sinon… — d’une certaine manière la linguistique s’occupe de propositions. Qu’est-ce que c’est qu’une proposition au sens linguistique ? Je dirais de la linguistique qu’elle extrait des propositions à partir des phrases. Mais qu’est-ce que je veux dire ? Oh je veux dire une chose très, très simple. Je veux dire : une phrase c’est ce que les linguistes appellent, supposons, de la parole. [80 :00] Parole orale ou écrite. Or, la parole — vous sentez tout de suite que je me réfère à la distinction classique en linguistique langue-parole — la parole, c’est toujours un mélange de faits, c’est une bouillie la parole, c’est plein de trucs, la parole.
Un mélange de faits, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que ça mélange quoi ? Ça mélange des systèmes très différents. Quand vous parlez, vous mélangez des systèmes [81 :00] très différents. Qu’est-ce que ça veut dire, un système ? Les linguistes essaient — et c’est leur première tâche scientifique, disent-ils — de distinguer des systèmes de langue dans la parole ; un système. Un système se définit comment ? De deux manières : son homogénéité d’ensemble, c’est-à-dire homogénéité des règles de formation, son homogénéité d’ensemble et la constance de certains éléments. Eléments constants, homogénéité de l’ensemble. C’est abstrait. [82 :00]
Exemple : l’américain parlé — exemple que j’invoque avec d’autant plus de bonne foi que je ne le parle pas — l’américain parlé : lui correspondent plusieurs systèmes linguistiques. Prenons-en deux. Ce que je dis est perpétuellement dit par les linguistes, mais, je précise, est maintenu par [Noam] Chomsky. Donc, si vous voulez, de [Ferdinand de] Saussure à Chomsky, les linguistes nous disent : le travail scientifique sur une langue suppose qu’on ait déjà dégagé des systèmes homogènes et cohérents [83 :00] qui font l’objet de l’étude scientifique : ce n’est pas la parole qui peut être étudiée scientifiquement, ou, du moins, elle ne peut pas l’être immédiatement, elle ne peut l’être que par après. Ce qui compte d’abord c’est la détermination de systèmes homogènes et cohérents.
Exemple : l’américain parlé, je retiens deux systèmes. L’un, on l’appellera « l’américain standard », l’autre, on l’appellera « le black English », la langue des noirs américains. Qu’il y ait des chevauchements, des empiètements, ce n’est pas la question. On peut définir deux systèmes. Par exemple, les règles du participe passé ne sont pas les mêmes. [Pause] Bien. [Pause] Quand je dis : [84 :00] le linguiste part des phrases et il en extrait des propositions, je veux dire : il part d’un mélange de fait — la parole — et il extrait des systèmes dont chacun est homogène et cohérent. Un système « américain standard », un système « black English », pour ne retenir que deux systèmes. Ce sont ces systèmes, et seulement ces systèmes qui font l’objet d’une étude scientifique. Recherche des constantes et des règles d’homogénéité. C’est clair ? Bon. [Pause]
C’est la première chose qui m’importe. Je dirais que : une proposition au sens linguistique, [85 :00] c’est ce qui fait partie de l’un ou l’autre des systèmes. Vous voyez que la proposition linguistique n’est pas tout à fait la même que la phrase. La phrase mélange les systèmes, la proposition linguistique appartient à un système définissable par l’homogénéité de ses règles et la constance de ses éléments. Bien. Ça me suffit pour le moment. J’en suis toujours à mon premier point.
Ça me suffit pour le moment. J’ai l’air de penser à tout à fait autre chose. Je vous disais : un livre fondamental sur les énoncés de sexualité, c’est le grand classique de [Richard von] Krafft-Ebing, Psychopathia [86 :00] sexualis. Ceux qui ne l’ont pas lu, je ne saurais trop vous en recommander la lecture puisque vous apprendrez là le secret de toutes les perversions, y compris une perversion fantastique, hélas tombée dans l’oubli, à savoir la perversion des coupeurs de nattes, [Rires] qui, à un moment, ont eu un grand succès dans le métro. C’était des individus ignobles qui se glissaient derrière des jeunes filles aux belles nattes et coupaient les nattes de ces jeunes filles. Et je dis ça parce que ça avait été, quand j’ai lu, moi, Krafft-Ebing, dans l’enthousiasme et en même temps l’horreur morale la plus pure, [Rires] j’avais été stupéfait de ceci que Krafft-Ebing, qui a tout vu, tout connu, il est expert des tribunaux, [87 :00] tout ça, et il garde un sang-froid imperturbable devant les choses les plus immondes, … les cas de sadismes qui vous font frémir, ou bien de tous leurs masochistes, tout ça, on peut à peine lire ça tellement on a les, les…, c’est insupportable, ou bien les gens qui vont déterrer des cadavres, des abominations, des horreurs, des horreurs, des horreurs.
Donc : il a tout vu, et puis il y a un moment où il craque. Ça c’est prodigieux. Le psychiatre s’écroule. Comme quoi, on ne peut jamais dire « je peux tout supporter ». Lui il a tout supporté, les éventrations, les extractions de viscères, tout ça, tout y passe, il est parfait, on dirait qu’il dit des choses insignifiantes quoi, ça va de soi ça pour lui. Puis, tout d’un coup, il perd les pédales. Il parle des coupeurs de nattes [Eclats de rires] [88 :00] et, on ne comprend plus du tout, et Krafft-Ebing se met à dire : de tels individus — je cite hein, c’est resté dans mon cœur à jamais [Rires] — de tels individus sont tellement dangereux qu’il faut à tout prix les soustraire et leur retirer la liberté. Pour les sadiques qui tuent, pour le sergent Bertrand qui déterre les cadavres, il n’a eu que des mots froids d’homme de science. Pour la petite fille et ses nattes, il s’écroule. Il dit : c’est odieux. C’est très curieux, hein ? C’est très, très curieux. Ça, c’est les seuils des gens.
Les gens, ils ont toujours des seuils : vous verrez un sadique terrible, tout d’un coup un masochiste et puis, il se retourne un petit ongle et il s’écroule. Alors que, la veille, il se faisait faire des brûlures abominables, il se trouve que, ça, il ne le supportait pas. Je connais quelqu’un — tout ça c’est un cours de morale, [89 :00] je le transforme en… — je connais quelqu’un — et je comprends très bien ça — qui supporte, et en vertu de son métier même, il est forcé, il supporte les morts, le spectacle des morts, de la mort, dans les conditions les plus tristes, les plus terribles, mais il y a une chose qu’il ne supporte pas, c’est l’image d’un bateau qui coule. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des images de bateaux qui coulent, on voit ça au cinéma souvent, et on croit comprendre, parce qu’il y a quelque chose de tellement pathétique, c’est à la limite du supportable. La manière dont un bateau coule, c’est comme si, là, c’était une mort plus terrible encore que toute mort d’homme, c’est une espèce d’effondrement, mais d’effondrement… Eh bien, là, il craque.
Eh bien, le grand Krafft-Ebing craquait à l’idée que l’on puisse couper les nattes d’une [90 :00] jeune fille. Pourtant ça ne fait pas très mal… Enfin c’était ce qu’on appelle une digression, ce que j’ai fait là. Alors le grand Krafft-Ebing, je vous l’ai déjà dit, qu’est-ce que c’est qu’un énoncé Krafft-Ebing, c’est très curieux, c’est un énoncé à cheval sur deux langues. Il écrit en allemand et, dans sa phrase allemande, dès que ce qu’il dit offense la pudeur, il le dit en latin, et en italique. Si bien que vous ne pouvez pas lire Krafft-Ebing si vous n’avez pas fait de latin, du moins quelque chose vous échappe. Bien. Je dirais [91 :00] typiquement : les énoncés de Krafft-Ebing — et là je pèse mes mots — les énoncés de Krafft-Ebing sont à cheval sur deux systèmes. Je ne dis pas : Krafft-Ebing parle tantôt allemand tantôt latin, je ne parle pas d’un mélange de fait, je parle d’une organisation de droit. Les énoncés de Krafft-Ebing ne cessent de passer du système allemand au système latin et du système latin au système allemand. Vous me direz : c’est un cas, c’est un cas un peu spécial ; [92 :00] continuons.
Je crois que Foucault est assez proche, et inversement — car je ne suis même pas sûr que Foucault connaisse cet auteur — d’un linguiste américain spécialiste de ce qu’il appelle lui-même sociolinguistique, qui s’appelle [William] Labov — je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr, L-A-B-O-V [Deleuze répète les lettres plusieurs fois] ça va ? Labov, oui ? c’est ça, non ? Labov, hein ? — Labov fait des études qui me paraissent très, très intéressantes, je dis, je dis, vous comprendrez pourquoi ça me paraît proche de Foucault. Il fait des études sur, par exemple, un petit noir américain qui explique quelque chose, et Labov se demande, [93 :00] par exemple, combien de fois, sur une courte durée — par exemple deux minutes, il explique un jeu, par exemple un jeu très compliqué entre gamins noirs à Harlem — il se demande en combien de fois, en deux minutes, le gosse passe du black English à l’américain standard et inversement, avec, comme dit Labov — et c’est très intéressant, ça, il me semble — avec de larges plages d’indiscernabilité, c’est-à-dire des segments qu’on peut aussi bien rapporter au black English qu’à l’américain standard. C’est tantôt, tantôt. On a envie tantôt de les rapporter au black English, tantôt à l’américain standard. En d’autres termes, le petit noir ne cesse de déraper, [94 :00] c’est-à-dire de passer d’un système à l’autre, il fait une transversale de systèmes. Ses énoncés tracent une transversale de systèmes. Il ne cesse de passer d’un système hétérogène à un autre.
Si vous me suivez, vous devez sentir que l’on tient quelque chose là. Je m’en tiens à ces deux exemples, Krafft-Ebing et Labov. Deux exemples très, très différents. Mais, pensez : qu’est-ce que vous faites quand vous parlez ? Vous ne cessez pas de tracer des transversales entre systèmes. Vous comprenez, quand… même… [95 :00] c’est par là que, la linguistique, ce n’est rien s’il n’y a pas une pragmatique. Je veux dire, même, je prends mon exemple misérable, je fais court : bon, j’en ai marre, bon, je me mets à raconter un truc sur les nattes de…, ce n’est pas le même système que ce que je disais avant… je fais une transversale, une manière de gagner du temps, bon. Ou bien, non ! Ou bien j’ai un haut souci pédagogique, qui fait que je me dis : ils sont fatigués, ils ne peuvent plus bien suivre, alors j’essaie de me faire spirituel… rien du tout ! mais ça n’empêche pas. Alors que je me réclamais tout à l’heure d’un système homogène philosophique, voilà que je tombe dans un système, système des astuces bon, bon, ça vaut ce que ça vaut… j’ai fait une transversale… [96 :00] Bien. On n’arrête pas dans la vie. On n’arrête pas. Bon.
Qu’est-ce que nous dit Chomsky ? Chomsky nous dit : ah oui, mais ça tout le monde le sait, il dit, Chomsky. Il dit, tout le monde le sait, c’est la situation de fait, mais jamais une science ne s’est constituée sur le fait, une science doit découper dans les faits, ses systèmes. La science ne commence… Bien entendu, quand vous parlez, dit Chomsky, vous mélangez des systèmes, mais la science ne peut être qu’une science des systèmes dégagés les uns des autres, vous comprenez ? C’est un peu comme pour [97 :00] la physique, bien entendu, la perception mélange toutes sortes de systèmes, mais la physique scientifique, elle, ne peut s’établir que si elle sépare les systèmes hétérogènes, pour constituer des systèmes homogènes. Vous comprenez ? Voilà la position de Chomsky.
La position de Foucault-Labov, elle consiste à dire : mais, il n’a rien compris Chomsky, il n’a rien compris du tout. Le problème n’est pas du tout du “fait”. Bien sûr on mélange en fait. Mais le problème de droit, c’est : est-ce qu’il y a des systèmes homogènes en droit ? Est-ce qu’il y a des systèmes homogènes ? [98 :00] Est-ce que ça veut dire quelque chose un « système homogène » en linguistique ? Et supposez que, en droit, il n’y ait que des passages, il n’y ait que des variations, il n’y ait que des transversales entre systèmes ? A ce moment-là, tout change. A savoir : ce qui a une valeur de droit, ce ne sont plus les propositions, chacune replacée dans le système cohérent et constant, homogène et constant, ce sera quoi ? Ce qui compte, c’est l’énoncé. Et comment l’énoncé se définit-il par différence avec la proposition ? Tout énoncé est le passage “en acte”, le passage “en acte” d’un système à un autre, [99 :00] par opposition aux propositions qui, elles, appartiennent à tel ou tel système.
Les énoncés de Krafft-Ebing, c’est l’ensemble des règles d’après lesquelles il ne cesse de passer, dans une même phrase, d’un segment allemand à un segment latin. Les énoncés du petit noir américain d’Harlem, c’est l’ensemble des règles par lesquelles il ne cesse de passer, d’un segment d’anglais standard à un segment black English, et inversement. En d’autres termes, les règles d’un énoncé sont des règles de variation. [100 :00] L’énoncé est l’instance linguistique qui comprend les variations, c’est-à-dire les passages d’un système à un autre. Dès lors, l’énoncé s’oppose à la proposition. Et il n’y aura pas d’énoncé s’il n’y a pas de passage d’un système à un autre hétérogène. Ce qui revient à dire — et vous reconnaîtrez là du Foucault — ce qui revient à dire l’énoncé n’est pas une structure, l’énoncé est une multiplicité. On appellera structure la détermination d’un système homogène en rapport avec ses constantes. On appellera « multiplicité » [101 :00] l’ensemble des passages et des règles de passage d’un système à un autre système qui lui est hétérogène. Or il n’y a pas de systèmes homogènes ; il n’y a que des passages entre systèmes hétérogènes.
Donc, si vous voulez dégager — là c’est très concret — si vous voulez dégager l’énoncé qui correspond à une phrase, voilà ce qu’il faut faire : non pas chercher les propositions linguistiques qui correspondent à la phrase, mais faire tout autre chose, déterminer quel passage d’un système à un autre la phrase opère, dans les deux sens, et combien de fois. A ce moment-là, vous aurez un énoncé. Non seulement les énoncés vont par multiplicité, [102 :00] mais chaque énoncé est lui-même une multiplicité. Il n’y a pas de structure, il n’y a que des multiplicités.
Voilà, ben ça me suffit pour le premier niveau, je ne sais pas si vous en demandez plus, j’essaierai de dire plus, mais ça me paraît déjà quelque chose de très, très pratique, qui montre à quel point ce qu’il appelle énoncé n’a aucun correspondant au niveau des propositions qu’étudient les linguistes. Une proposition linguistique est par nature définie par son appartenance à un système homogène défini par des constantes. Un énoncé, c’est exactement le contraire. Donc, nous sommes tous des Krafft-Ebing, bien que nous ne parlions ni allemand, ni latin, [103 :00] car nous ne cessons pas de passer… Vous me direz : mais, dans le cas de Krafft-Ebing, c’est très simple, c’est pour des raisons de pudeur, c’est-à-dire qui n’ont rien à faire avec le langage, et c’est bien ce que dirait un linguiste, mais c’est idiot. C’est complètement idiot. Car, les raisons de pudeur, vous pouvez toujours les assigner à l’extérieur du langage, mais c’est aussi des variables de la langue. C’est en tant qu’il parle et c’est en tant qu’il produit des énoncés que Krafft-Ebing les compose avec de l’allemand et du latin. Or c’est notre cas à tous, on est toujours à cheval sur plusieurs langues. C’est bien : on est tous bilingues. Bien plus : on est multilingues, simplement on ne le sait pas. Vous me direz que j’emploie la langue en un sens illégitime : pas du [104 :00] tout, je l’emploie au sens le plus strict, système homogène défini par des constantes. Ouf : voilà un premier point, très clair. Pas de questions ? Pas de questions, pas de questions.
Deuxième niveau. Et là, c’est évident, il y a le choix à faire ; je veux dire, vous ne pouvez pas maintenir les deux à la fois. Vous ne pouvez pas dire : sur un certain plan, c’est les linguistes qui ont raison et, sur un autre plan, c’est la multiplicité. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas maintenir les deux positions. Vous ne pouvez pas maintenir les deux positions. Si vous croyez aux multiplicités, [105 :00] vous ne pouvez dire qu’une chose, c’est que chaque segment, si petit qu’il soit, de ce que vous dites, chaque segment linguistique, est passage entre des systèmes hétérogènes. Vous ne trouvez jamais un segment, quel qu’il soit, qui n’appartienne qu’à un système. Donc, si vous voulez, la théorie des multiplicités, il me semble, s’oppose radicalement, en ce sens, au structuralisme. Et Foucault a raison, complètement raison de dire, déjà dans L’Archéologie du savoir, qu’il n’est pas structuraliste.
Je crois que, en effet, il fait partie de ceux qui croient à une doctrine des multiplicités, à une théorie des multiplicités, or les multiplicités n’ont rien à voir avec des structures. C’est autre chose. Pourquoi ? Parce qu’encore une fois ce sont des règles de passage entre systèmes hétérogènes, et pas du tout des règles de formation de systèmes homogènes. [106 :00] Alors, vous me direz : pour qu’il y ait des passages entre systèmes hétérogènes, il faut bien qu’il y ait des systèmes dont chacun est homogène ? Non, ce n’est pas vrai. S’il n’y a que des passages entre systèmes hétérogènes, ça veut dire que l’idée d’un système homogène pour son compte est une abstraction, et non seulement une abstraction, mais une abstraction illégitime. Seul le passage compte. Voilà, d’où deuxième niveau.
Eh bien, deuxième niveau : je prends cette fois-ci la phrase. Eh bien, la phrase renvoie à un sujet, mais le sujet auquel elle renvoie, c’est le sujet d’énonciation, bizarrement dit d’ailleurs, « d’énonciation ». [107 :00] Une phrase a un sujet d’énonciation qui ne se confond pas avec le sujet d’énoncé. Si je dis « le ciel est bleu », le sujet d’énoncé c’est « le ciel » et ce n’est pas le sujet d’énonciation.
Qu’est-ce que le sujet d’énonciation de la phrase ? C’est la phrase en tant qu’elle renvoie à une personne grammaticale. Qu’est-ce qu’une personne grammaticale ? La personne grammaticale, c’est « je ». [Pause] [108 :00] « Je » est le sujet d’énonciation de la phrase. N’importe quel je ? Non. Il y a des « je » qui ne sont qu’en apparence personne grammaticale. Si je dis « je me promène », il n’y a pas de différence de nature entre la phrase « je me promène » et la phrase « il se promène ». Dans un cas, « il » est le sujet d’énoncé, dans l’autre cas « je » est le sujet d’énoncé. Donc dans la phrase « je me promène », « je » n’est pas sujet d’énonciation, il est uniquement sujet d’énoncé interchangeable avec « il ». [Pause] [109 :00] En revanche, je dis : « je le jure », « je le jure », cette fois-ci le « je » n’est pas du type « je me promène », pourquoi ? Parce que je ne me promène pas en disant « je me promène ». Je peux promener et dire « je me promène », mais ce n’est pas la même chose. Tandis que, quand je dis « je le jure », je jure en disant « je le jure », ça c’est le sujet d’énonciation, la vraie personne linguistique. C’est la vraie personne linguistique, c’est la première personne. [110 :00]
Qu’est-ce que c’est ce « je », vraie personne linguistique ? C’est ce qu’on appellera, c’est ce que les linguistes appellent, un « sui-référentiel », ou, si vous préférez, un embrayeur. Comme on dit : il fait commencer le discours. Quelle est sa propriété très bizarre ? C’est que ce « je », sujet d’énonciation, ne désigne ni une personne, ni un concept. [111 :00] Ni quelque chose, plutôt, ni quelque chose ni un concept. Ni quelqu’un, ni un concept. Qu’est-ce qu’il désigne ? Il désigne uniquement celui qui le dit. Est « je », celui qui dit « je ». Est « je », celui qui le dit, c’est ça la formule du suis référentiel. Il fait commencer le discours. Bien.
En d’autres termes, la phrase trouve dans la première personne le sujet d’énonciation par laquelle ou auquel elle se réfère. Ce sujet d’énonciation, c’est le « je » comme première personne irréductible à la troisième personne. Irréductible à la troisième personne, le « je » de « je me promène » [112 :00] est, au contraire, parfaitement réductible à la troisième personne. Ce que je viens de résumer, très, très sommairement, c’est une théorie célèbre, en tous cas en France, que vous trouvez partout, mais je l’ai résumée particulièrement sous le point de vue de [Émile] Benveniste, Problèmes de linguistique générale [1963], puisque ceux d’entre vous qui ont fait de la linguistique ont reconnu dans ce que je racontais un thème très proche de ce que les Anglais et les Américains ont appelé les actes de parole… [Interruption de l’enregistrement] [1 :52 :33]
Partie 4
… Objection : est-ce qu’il n’y a pas des langues sans première personne ? Benveniste consacre — qui est un excellent linguiste, donc, là, je ne me permets pas de… — Benveniste dit que, même quand la première personne n’apparaît pas, sa place est là. Il invoque le japonais — : tu confirmes ? [113 :00] Très bien ! [Deleuze s’adresse sans doute à Hidenobu Suzuki qui enregistre la séance] — Il va de soi là-dessus, que, dans une phrase, ce « je » comme sujet d’énonciation peut être sous-entendu. Il ne faut pas me citer des phrases qui ne soient pas du type « je le jure », ça, évidemment, il y en a plein. Et, qu’il soit sous-entendu, ça ne change rien : la phrase renvoie à un sujet d’énonciation sous-entendu ou exprimé. Bien.
En d’autres termes, je dirais : ce sujet d’énonciation, c’est une constance intrinsèque, c’est une constante intrinsèque. Là-dessus, vous remarquez que n’importe qui peut venir à la place de ce « je » linguistique. Est « je » celui qui le dit. En effet, je dis « je », mais, toi, tu vas dire « je » tout à l’heure. Ou tu dis « je » en même temps. Est « je » celui qui le dit. [114 :00] Donc la formule, de la phrase-là, c’est : constante intrinsèque, variable extrinsèque. La constante intrinsèque c’est le sujet d’énonciation, le « suis » référentiel, l’embrayeur. Les variables extrinsèques, c’est l’infinité des individus qui peuvent dire « je ». D’accord ? Je définirais donc la phrase par sa constante intrinsèque, les variables étant nécessairement extrinsèques. C’est la forme du « je » en linguistique. Bien. [Pause]
Eh bien, peut-être que c’est valable [115 :00] pour les phrases tout ça, mais ça montre que, les phrases, ce n’est pas un truc bien intéressant. Car — et je ré-enchaîne avec Foucault — car, car quoi ? Car, au niveau des énoncés, vous allez voir tout à fait autre chose. Un énoncé, il renvoie bien à un sujet – ça oui, pas de problème. Il renvoie à un sujet. Ah, mais, ça se complique parce que, non seulement il renvoie à un sujet, mais il risque de renvoyer à pleins de sujets, il en a plutôt trop. Vous sentez déjà que le « je » ne va pas convenir pour exprimer le sujet de l’énoncé. Il en a trop de sujets. Parce que, d’une part, voilà, [116 :00] d’un énoncé à l’autre, le sujet risque fort de varier en nature.
Deuxième point : pour un même énoncé, il y a bien des risques pour qu’il y ait plusieurs sujets, bien entendu qui ne se réduisent pas à un « nous », plusieurs sujets hétérogènes. Oui, commençons donc. Plusieurs… Suivant les énoncés, le sujet est très différent. Ben, oui. [Deleuze cherche dans un texte] Voilà un texte curieux, tiré d’une conférence qui était “Qu’est-ce qu’un auteur ?” [1969] Foucault dit, un auteur, est-ce qu’un énoncé [117 :00] a nécessairement un auteur ? Il dit : non, un énoncé peut avoir un auteur, il y a certains énoncés qui ont un auteur, notamment, par exemple, les énoncés littéraires. On me dit quelque chose, je dis : « c’est de qui ça ? », on me répond : « c’est de Victor Hugo ». Il y a un auteur. Donc certains énoncés ont pour sujet, sujet d’énonciation, un auteur.
Mais il y a des énoncés qui n’ont pas d’auteur. Par exemple : une lettre que j’écris. Est-ce que je vais dire : je suis l’auteur de la lettre ? Oui, parfois. Je dirais « je suis l’auteur de la lettre », si c’est une lettre criminelle anonyme. A ce moment-là « auteur », ça ne signifie plus « auteur littéraire », ça signifie « auteur du délit ». Une lettre anonyme a un auteur : auctor delictis ! [118 :00] Vous voyez, je viens de faire comme Krafft-Ebing, je viens de produire un énoncé. Comme dit Foucault, les énoncés, ce n’est pas difficile à produire [Rire de Deleuze], on en produit tout le temps et pourtant ils sont rares, il dit, en effet, parce que… c’est très cohérent les deux choses… bon, peu importe.
Bon, une lettre, sinon, ça n’a pas d’auteur ! Ah, mais, ça n’a pas un auteur, ça a un signataire. Est-ce que la fonction « auteur », c’est la même chose que la fonction « signataire » ? Non. Si j’écris à un copain : « je ne peux pas venir au rendez-vous, salut » », je ne peux pas dire que je suis auteur de la lettre, je suis le signataire de la lettre. Mais, si je suis Madame de Sévigné… ? Ah, ça se complique. Je suis signataire par rapport à ma fille à qui j’écris, [119 :00] ma fille bien-aimée, mais je suis aussi auteur, puisque ma fille fait circuler dans les milieux littéraires ma lettre, en disant « vous avez vu la lettre que ma mère vient de m’envoyer ? Qu’est-ce qu’elle est bien ! », et qu’on fait des lectures publiques de la lettre de Madame de Sévigné, elle est auteur. Voilà qu’un même énoncé a deux sujets : Mme de Sévigné comme auteur, Mme de Sévigné comme signataire, ce n’est pas pareil. Bon.
Prenons alors un cas comme [Marcel] Proust, invoqué par Foucault. La première phrase de La Recherche du temps perdu : “longtemps je me suis couché de bonne heure”. Foucault demande, il pose une question très simple, je crois qu’on est armé pour la comprendre maintenant : est-ce que c’est une phrase ? Elle reste la même. Est-ce que c’est le même énoncé ? [120 :00] Si c’est moi qui le dis, j’ai pu le dire par hasard un jour, j’ai dit à un ami, comme ça : « oh tu sais, longtemps je me suis couché de bonne heure », sans savoir que c’était dans Proust, ce n’est pas une phrase très compliquée. Je ne suis pas auteur, je suis, à ce moment-là, locuteur de la phrase. Mais quand Proust l’écrit comme première phrase de La Recherche du temps perdu, il est auteur de la phrase. Est-ce que la phrase ne renvoie qu’à un auteur ? Non, elle renvoie à un narrateur, qui n’est pas l’auteur. La phrase a deux positions de sujet : l’auteur, le narrateur. [Pause]
Une lettre a un signataire et pas forcément un auteur. Et, Foucault continue : un contrat [121 :00] a un garant. En effet c’est le terme technique, il n’a pas d’auteur. Un texte que l’on lit dans la rue, sur un mur, a un rédacteur, ce n’est pas la même chose qu’un auteur. Vous voyez, il y a énormément, il y a énormément… : auteur, rédacteur, narrateur, signataire… enfin, la liste est ouverte, vous pouvez en inventer, vous pouvez en inventer plein. Et, j’insiste que, dans mes exemples, j’ai déjà débordé sur l’autre cas, à savoir : un même énoncé qui renvoie à plusieurs types de sujets. L’énoncé de Madame de Sévigné, l’énoncé de Proust, qui passe par un auteur et un narrateur, ou bien — pour ceux qui étaient là les autres années, on est resté là-dessus assez longtemps — l’exemple du discours indirect libre. [122 :00] Dans le discours indirect libre, vous avez court-circuit de deux sujets de positions absolument différentes. Je redis pour ceux qui n’étaient pas là, pour qu’ils comprennent, parce que, là, c’est lumineux.
Un énoncé de discours indirect libre, c’est très intéressant, c’est exactement un énoncé que vous mettez dans une énonciation qui ne dépend pas du même sujet d’énonciation. Si vous voulez c’est : « je lui dis de ne pas faire ce voyage. Elle prendrait toutes les précautions et n’avait pas de conseil à recevoir de moi ». Vous voyez, cette forme que vous trouvez très souvent dans le roman, c’est un discours indirect libre, parce que le discours indirect, ce serait : « je lui dis de ne pas faire ce voyage, elle me répondit : qu’elle prendrait toutes les précautions et qu’elle n’avait pas de conseil à recevoir de moi », [123 :00] et là, il y a une espèce de rupture. « Je lui dis de ne pas faire ce voyage »…, il n’y a pas « elle me répondit que… », il y a « …elle prendrait toutes les précautions » etc. C’est le sujet d’énonciation « elle » qui vient se glisser dans mon énoncé dont, moi, je suis le sujet. Il y a comme glissement d’un sujet d’énonciation dans un autre sujet d’énonciation. C’est un très beau cas le discours indirect libre.
Alors, les linguistes, ils sont… pour rendre compte du discours indirect libre, ils échafaudent parfois des théories passionnantes. C’est un très très beau problème. Une fois dit, quand ils sont stupides, ils disent : “le discours indirect libre, c’est un mixte de discours direct et indirect” ; ça c’est idiot, quoi, ça n’a aucun intérêt, en plus ce n’est pas vrai, grammaticalement ce n’est pas vrai, puisque il y a les temps grammaticaux du discours indirect qui ne correspondent pas aux temps de, [124 :00] ni de l’un ni de l’autre, donc il y a une originalité du discours indirect libre. Vous voyez : il y a immiscion d’un sujet, c’est comme un vampire, le discours indirect libre, c’est : un sujet d’énonciation qui vient en vampiriser un autre. Très beau cas. Là vous avez un énoncé qui renvoie à deux sujets d’énonciation. Bien.
Ce qui revient à dire quoi ? Eh bien, toutes ces positions de sujet, plus je reviens à Krafft-Ebing… lui, c’est encore autre chose, on pourrait continuer la liste de Foucault. Les énoncés de Krafft-Ebing, ils ne renvoient pas à un auteur, ils renvoient à quoi ? Quelque chose de très, très spécial dans la littérature, c’est ce qu’on appelle une compilation, un compilateur. C’est une très vieille chose, le compilateur. Heureusement qu’il y en a eu. [125 :00] Car c’est une chose qui, à mon avis, se forme chez les Grecs et les Latins. Je dis : heureusement qu’il y avait des compilateurs, puisque que, comme on n’a plus beaucoup de textes des Grecs et des Latins, une grande partie du peu qu’on a, nous vient de compilateurs. Alors un compilateur, par exemple, un compilateur célèbre chez les Romains, très, très utile, c’est une source de tout, c’est Aulu-Gelle. Aulu-Gelle, il fait un livre qui est composé de petits chapitres sur : dans quelles circonstances le poète tragique a-t-il dit ceci ? Et il cite cinq vers d’une tragédie perdue. Vous voyez : c’est une espèce de compilation. Chez Montaigne, il y a encore une espèce d’aspect, bien qu’il ne soit pas que compilateur, une espèce de compilation en acte. C’est très important, les compilateurs, parce qu’on connaît, grâce à eux, des choses. Eh bien, je dirais : Krafft-Ebing [126 :00] est un compilateur. Les énoncés de Krafft-Ebing renvoient à une position de sujet, dès lors, compilateur.
Qu’est-ce que ça veut dire tout ça ? Je conclus rapidement ce second point. Je dirais : contrairement aux phrases qui renvoient à une constante formelle, première personne, « je » comme première personne ou sujet d’énonciation, l’énoncé renvoie à des positions variables de sujet, parfois plusieurs pour un seul, et — vous allez tout comprendre — toutes ces positions de sujet s’ordonnent dans la cohorte, dans le long cortège d’un « on parle ». [127 :00]
Ce sont les figures d’un « on » plus profondes que tout « je ». Et, là, Foucault retrouve une nouvelle fois, [Maurice] Blanchot qui, à ma connaissance, est celui qui est allé le plus loin dans la direction suivante : destituer la personnologie linguistique, dénoncer les personnes grammaticales au profit d’un « il » ou d’un « on » plus profond, c’est-à-dire c’est l’anti-Benveniste. Benveniste dénonce la troisième personne comme une fausse personne, [Pause] Blanchot brandit le « on » comme l’expression [128 :00] de la non-personne et c’est la non-personne qui est le véritable sujet de l’énoncé. Si bien que toutes les positions de sujet, toutes ces positions variables qu’on vient de voir, viennent tour à tour marquer des figures du « on » sans briser l’anonymat de ce « on ». Et c’était le rêve de Foucault, quand il disait, dans L’Ordre du discours [Paris : Gallimard, 1971] « prendre ma place dans un murmure anonyme ». C’est-à-dire le nom propre n’est plus qu’une figure de ce « on parle » : Krafft-Ebing, Madame de Sévigné… tout ça, tout, tout, toutes les positions de sujet s’alignent comme les variables d’un « on parle ». Vous comprenez ?
Ce qui revient à dire quoi ? Ce qui revient à dire, on a vu tout à l’heure, la phrase se définissait [129 :00] par une constante intrinsèque et des variables extrinsèques. Constante intrinsèque, c’était le « je » comme sujet d’énonciation. Variables extrinsèques : tous les individus qui pouvaient dire « je ». Je dirais : l’énoncé, au contraire, se définit par un ensemble de variables intrinsèques. C’est la notion de variable intrinsèque.
Et ça s’enchaîne très bien avec mon premier niveau. Mon premier niveau disait : l’énoncé se définit par des règles de passages entre systèmes hétérogènes. Mon deuxième niveau dit : l’énoncé se définit par des variables intrinsèques, à savoir l’ensemble des positions de sujet auxquelles il renvoie, chaque position de sujet étant, dès lors, une figure du « on ». [130 :00] C’est un anti-personnalisme absolu. Il n’y a ni constante intrinsèque, ni variable extrinsèque, il n’y a que des variables intrinsèques de l’énoncé. Et là encore c’est très proche de Labov. Labov aussi, il fait une théorie des variables intrinsèques de la langue.
Eh bien, on a bien travaillé. Alors j’en suis au troisième niveau. Là, vous devriez pouvoir deviner : quel est ce troisième niveau ? Je vous le dis pour que vous y réfléchissiez : cette fois-ci, on revient à la proposition. On nous dit qu’une proposition a un référent, c’est-à-dire qu’elle renvoie à un état de chose. [131 :00] L’état de chose peut ou non remplir la référence. Je dis « le ciel est bleu ». La proposition renvoie à un état de chose : « ciel bleu ». Il se peut que le ciel soit noir, à ce moment-là la référence de la proposition n’est pas remplie, n’est pas effectuée. Ça n’empêche pas que la proposition a une référence. Je dirais que, dans le cas d’une proposition, il y a référence à un état de chose, c’est la constante, c’est la constante intrinsèque. Et l’état de chose est là ou n’est pas là pour remplir, pour effectuer, la référence, c’est la variable extrinsèque. [Pause] Bon. Pour un énoncé, [132 :00] ce n’est pas du tout ça. Pour un énoncé, c’est complètement différent. [Fin de l’enregistrement] [2 :12 :11]
For archival purposes, the transcription of this seminar by Annabelle Dufourcq took place starting in 2011 with the support of a Purdue University College of Liberal Arts grant. The translation was completed in 2018, and subsequent revision of the transcript and translation and time stamp were completed in December 2021 and April 2022. Additional revisions were added in February 2024, February 2025, and February 2026.